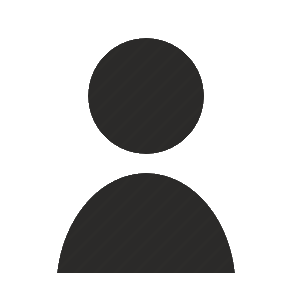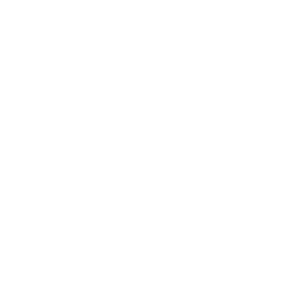This document is unfortunately not available for download at the moment.
La logique de la linguistique
Introduction
Hendrik Pos
Translated by Patrick Flack
pp. 27-42
Un des acquis les plus solides de la philosophie moderne est sans doute sa prise de conscience du fait que la logique ne constitue pas seulement une science formelle mais que, en lien étroit avec la théorie de la connaissance, elle doit s’orienter selon le matériau qui lui est fourni par les sciences particulières. Cette idée a été exposée de manière spécialement féconde dans les écrits des logiciens modernes, Sigwart et Wundt notamment. Christoph Sigwart postule ainsi dans sa Logique (I, 1911, p. 15), après avoir tout d’abord déclaré que la logique est une science formelle : « Nous ne voulons pas dire que la logique est formelle en ce sens que celle-ci doive tenter vainement de saisir la pensée comme une simple activité formelle qui pourrait être considérée indépendamment de tout contenu ou demeurer indifférente à toute différence de contenu ». Ce point de vue s’est imposé chez Sigwart surtout dans le deuxième volume de son ouvrage: le premier rappelle encore beaucoup la logique formelle (aristotélicienne). Wilhelm Wundt a lui rédigé en 1893 une Logique en trois volumes – le premier consacré à la logique générale, le second à la logique des sciences exactes et le troisième aux sciences humaines (voire Vol.1 Introduction §4 [Introduction de l’objet]) – où une méthodologie spécifique des principaux domaines scientifiques vient s’ajouter à la théorie générale de la méthode. La logique des sciences particulières s’est ainsi avérée être une théorie des buts, méthodes et concepts fondamentaux de ces dernières. Le double gain offert par cette approche est de permettre désormais à l’analyse conceptuelle d’éclairer autant la structure objective de l’objet des sciences en question que les conditions subjectives nécessaires à la connaissance de cet objet. Puisqu’il est dès lors naturel de penser que la valeur de telles analyses dérive de leur réponse à la fameuse question « Comment une science particulière est-elle possible ? », un examen plus détaillé de la méthode transcendantale semble ici de mise. Partant du fait de la connaissance scientifique, qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à mettre en doute, Kant s’est demandé comment celle-ci était possible. La manière même de poser la question révèle que la solution ne saurait être recherchée dans les deux parties qui contribuent à la constitution de la connaissance, le sujet et l’objet, mais bien dans un quelque chose qui les unit tous deux et qui rend possible leur relation mutuelle. Cette fonction est remplie par l’appareil catégorial. Certes, il a pu paraître un temps que Kant lui-même ne visait par là que quelque chose de subjectif et toute une série de penseurs éminents a ainsi cru discerner la forme la plus pure du kantisme dans ce subjectivisme. On peut cependant, sans tomber dans le dogmatisme, donner une tournure plus objective à la pensée critique, celle-ci se révélant alors comme étant la plus féconde et la plus adaptée pour les sciences particulières également. Il ne suffit pas de supposer que notre pensée apporte à la réalité – ou plutôt à ses objets – des formes qui seraient tout à fait étrangères à l’objet « en soi ». Dans ce cas, la question de savoir pourquoi la réalité tolère d’être modelée par des formes apparemment étrangères à son essence ou pourquoi elle se laisse pour ainsi dire manipuler resterait sans réponse. De plus, on ne pourrait alors éviter, d’une manière ou d’une autre, d’attribuer un fondement de validité objective à ces formes. Il est par ailleurs bien connu que Kant lui-même – bien qu’il ait apparemment cherché à embrasser la totalité des domaines du savoir avec sa question « Comment la science est-elle possible ? » – n’a utilisé principalement pour son modèle transcendantal que les sciences naturelles mathématisées, puis la psychologie et la métaphysique. Ce type de réductionnisme fut en son temps particulièrement utile pour les tentatives de généralisation de la méthode des sciences naturelles et leurs conséquences regrettables, maintenant fort heureusement dépassées. Mais beaucoup de choses ont changé depuis l’apogée de la philosophie des sciences naturelles. Ayant atteint un stade suffisamment avancé pour questionner ses propres fondements et méthodes, la psychologie s’est débarrassée du joug étranger des sciences naturelles. Le travail que des hommes tels que Dilthey, Windelband, Troeltsch, Rickert et d’autres ont effectué sur le terrain des sciences de l’homme, de la religion et de la culture a été plus pertinent encore à l’émancipation de la recherche hors des sciences naturelles. Il devrait être aujourd’hui indubitable que dans les sciences dites de la culture – aux rangs desquelles nous classons aussi la linguistique, ce qu’il nous faudra encore justifier – nous avons affaire à d’autres concepts fondamentaux et à d’autres méthodes. De même, il est clair que lorsque le matériau des sciences de la culture est saisi uniquement dans des catégories physicalistes, il est réduit à un chaos insensé (cf. H. Maier, Psychologie de la pensée émotionnelle, 1908, p. 45 : « Il ne s’est jusqu’à ce jour pas démenti que la logique a initialement porté son attention de façon quasi exclusive sur la pensée des mathématiques et des sciences naturelles »). Il n’est plus possible d’ignorer la tendance toujours plus forte qu’ont ces deux grands domaines du savoir à se scinder. Pour cette raison, on ne peut non plus complètement éviter la question de l’unité des sciences, puisque désormais même la logique et la méthodologie se désagrègent en domaines particuliers. Ces dernières donnaient certes l’impression de préserver au moins une certaine unité formelle là où la réflexion critique avait par nécessité déchiré celle de la conscience originaire, mais cette unité n’était en fait que le symptôme d’une absence de réflexion. Il est en tout les cas évident qu’on ne saurait trouver une telle unité dans le matériau des sciences. La différenciation des sciences particulières est en effet fondée logiquement sur le fait que, dans la totalité du donné, il existe des sphères qui s’isolent et se regroupent autour de points centraux fixes dès que la réflexion théorique se concentre sur elles. Bien que la question d’une logique et d’une méthodologie universelles dépasse en fait le cadre du présent ouvrage, il est néanmoins possible d’en esquisser ici une solution. À défaut, on pourrait à raison nous soupçonner de vouloir renoncer à l’unité totale de la science au profit d’une de ses parties. S’il en était réellement ainsi, toute solution que nous pourrions obtenir pour un domaine partiel serait elle aussi fausse. Ce qui est certain, c’est que l’ancienne logique formelle, notamment la théorie des syllogismes et des lois supérieures de la pensée, fournit l’exemple d’un modèle d’une validité universelle. Ce type de validité universelle est toutefois acheté au prix d’une absence de contenu et de là découlent les limitations et la stérilité de l’ancienne logique formelle. Parce que cette logique se laisse justement appliquer à n’importe quel matériau, elle peut être indépendante de tout matériau, autrement dit être sans contenu. Le matériau ne se laisse saisir en effet que par différenciation. Son caractère de détermination est d’un type tout particulier. La possibilité que l’on puisse peut-être dans le futur tirer quelque chose d’un traitement comparatif des logiques des différents domaines du savoir doit être ici mise en parenthèse. Une telle entreprise vaudrait certainement la peine d’être tentée. Mais plutôt que d’être en mesure de produire une logique générale, elle la présuppose en fait. Selon toute vraisemblance, pareilles tentatives ne pourraient de toute façon pas remplacer ou rendre superflues les fondations logiques des sciences individuelles. Même si l’exposition la plus abstraite possible d’un système universel de catégories embrassant le champ entier du pensable devait réussir, un retour par spécification à la couche des données originaires resterait inévitable d’une manière ou d’une autre. Il est par ailleurs évident que la différenciation est nécessaire à la méthodologie et à la logique depuis qu’il a été établi, d’une part, que la logique formelle est une discipline relativement stérile pour les divers domaines scientifiques concrets, et d’autre part, que chaque science travaille avec des méthodes et des concepts fondamentaux qui dépendent des propriétés de leur matériau et qui ne se laissent découvrir que par une analyse critique de ce même matériau. En effet, c’est un fait historico-psychologique immuable que chaque science approche son matériau de façon naïve dans les stades initiaux de son travail et que ce n’est que plus tard que son travail critique fondamental commence ou peut commencer. Natorp écrit de façon révélatrice dans la préface de sa Psychologie, Vol.1, 1912 : « J’ai nommé cela des « questions liminaires » [Vorfragen]. Quelqu’un m’a objecté qu’il s’agissait plutôt de questions subséquentes [Nachfragen] ». Il faut insister avec force sur ce dernier point. La puissance de transformation du matériau est un fait dont l’oubli peut expliquer pour bonne part l’incompréhension qui règne entre science et philosophie des sciences. La philosophie peut tout aussi peu vouloir s’abstraire complètement du matériau des sciences particulières (car même les « formes » les plus abstraites de la connaissance sont les formes d’un certain matériau), que l’on ne peut exiger d’elle qu’elle se dissolve dans les sciences particulières ou qu’elle leur fasse entièrement place. On obtiendrait dans ce cas rien d’autre qu’un retour à un réalisme naïf qui postulerait que les choses sont telles que nous les voyons immédiatement ou qui, bien plutôt, ne constituerait pas un point de vue philosophique du tout mais simplement l’opinion irréfléchie d’un homme ne s’interrogeant pas sur le monde. Cela dit, le type d’intellectualisme écervelé qui, par l’entremise d’une exagération simpliste et d’une vision trop littérale, érige en slogan une Raison prescrivant ses propres lois à la nature est tout aussi indéfendable et peu scientifique. L’idée que la forme n’est donnée au matériau informe de la connaissance que par nous s’oppose de manière irréconciliable avec la détermination constante du matériau « informé » qui, dans la connaissance, est toujours déjà saisi dans une forme. Si le matériau « en soi » est informe et que toute donation de forme provient de nous, d’où proviendrait alors cette détermination ? Elle n’est possible que grâce à une interaction ou un ajustement – qu’il nous est impossible de fonder mais qui peut néanmoins être postulé avec certitude –, entre forme et contenu. Quelle est dès lors, demandons-nous, la place d’une logique des sciences ? Quel est son objet et quelles sont ses tâches ? Il semble que cette discipline, pour autant qu’elle ait un sens, se donne d’autres objectifs que ceux de la science qu’elle cherche à servir. Peut-être peut-on parler d’une différence dans l’orientation de la recherche, car le matériau reste le même. Si, comme on l’a mentionné, chaque science est en premier lieu orientée vers la saisie ou le traitement conceptuel d’un matériau, le concept même de « traitement » présuppose qu’on doive utiliser des concepts qui eux-mêmes ne sont pas le matériau qu’ils traitent. Sans la distinction entre le matériau et le mode de sa saisie, aucune science n’est possible. Kant et la philosophie critique qui se rattache à lui, en particulier les travaux récents de H. Rickert1, démontrent tout à fait clairement à quel point le traitement modifie le matériau. Nous voulons quant à nous éprouver à l’exemple du matériau linguistique la validité générale de l’idée qui postule que le matériau subit une « transformation » dans la saisie théorique qui le constitue comme objet théorique. Si cela devait réussir, on démontrerait de façon nouvelle la fécondité pour les sciences particulières de délibérations épistémologiques d’ordre général. Ainsi donc, les concepts qui servent le matériau sans pour autant se retrouver eux-mêmes au niveau du matériau originaire peuvent à leur tour être soumis à une étude. Leur propriété particulière est qu’ils ne sont là que pour le matériau, ils le désignent sans eux-mêmes appartenir au matériau mais en étant malgré tout nécessaire à sa saisie. Ces abstractions se révéleront être de véritables concept de « forme », ce qui n’implique toutefois pas qu’ils soient indéterminés ou vides, car même la « forme » ne peut être comprise que comme quelque chose qui a un contenu – et cela quand bien même les faits nous obligent aussi à établir une gradation hiérarchique entre ce qui a plus ou moins de contenu. Il est en tout cas clair que les sciences particulières n’ont jamais reçu beaucoup d’assistance de la part d’une logique ou d’une méthodologie universelle. Tout ce qui a pu se détacher, consciemment ou non, de certains champs spécifiques du savoir avec la prétention de fournir une vraie méthodologie ou une logique universellement valide ne saurait en fait véritablement porter ce nom. Les disciplines usurpées ont d’ailleurs toujours pris leur revanche sur l’arrogant intrus en l’ignorant et en poursuivant leur propre chemin.
Au vu des considérations qui précèdent, l’idée d’une logique des sciences particulières nous semble dans un premier temps justifiée. L’intention du présent ouvrage sera dès lors de contribuer à une telle logique pour la linguistique, tout en étant conscient que cela ne peut se faire productivement que sur la base des recherches déjà existantes. Les travaux de Steinthal, von der Gabelentz, Wundt, Sigwart, Maier, Paul, Dittrich et autres offrent de nombreux éléments de valeur à cette fin. Je dois par ailleurs à Rickert – bien qu’il ne se soit jamais consacré aux problèmes spécifiques posés par la linguistique générale – une grande inspiration en ce qui concerne la théorie de la connaissance. Que ce soit dans les sciences non-exactes en général ou dans la linguistique en particulier, il ne demeure toutefois aujourd’hui plus que de timides restes de la constante relation que les sciences naturelles avaient entretenue depuis Kant avec la philosophie critique. La linguistique moderne semble ne vouloir affirmer son droit d’être une science particulière qu’en se limitant à l’excès au donné empirique immédiat, de sorte que la possibilité d’un approfondissement dans le sens de ses concepts fondamentaux et de ses conditions générales menace de se refermer (cf. Paul, Principes. p. 3). Le présent travail pourra ainsi parfois donner l’impression de se frayer un chemin dans une jungle tropicale qui a certes été éclaircie ici et là, mais où il nous faut continuellement avoir le matériau à la main afin de surmonter des obstacles nouveaux surgissant sans cesse. Avec l’aide des travaux susmentionnés, notre ambition sera de relier notre science aux résultats de la logique et de la théorie de la connaissance modernes. Il n’est pas certain a priori que cela soit possible sans faire violence au matériau. Mais même si le résultat devait s’avérer assez négatif, on gagnerait quelque chose quant à la relation encore peu claire entre la théorie de la connaissance et les sciences particulières. Une chose est d’ores et déjà certaine : la validité de la recherche empirique ne saurait d’aucune manière être remise en cause ou remplacée par nos études. Au contraire, notre but sera seulement d’apporter un éclaircissement conceptuel à la recherche empirique, une réflexion sur ses fondements et ses objectifs. Lorsque la logique interroge les fondements possibles de la connaissance factuelle, cette question n’est elle-même de facto possible que là où une connaissance existe déjà. De la sorte, la logique ne peut pas être utile à une science particulière en ce sens qu’elle lui permet de découvrir des données nouvelles et utiles qui sans son aide ne seraient pas accessibles. Pour son propre intérêt, la logique doit laisser la quête des faits à la recherche empirique, car elle ne peut pas subsister en tant que logique sans celle-ci. « Tout fait est déjà théorie », voilà le slogan de la réflexion critique. Pour que cela se vérifie, il faut toutefois d’abord qu’il y ait des faits, et c’est la connaissance empirique qui s’occupe de cela. On peut même déclarer que l’étude critique est dépendante de cette dernière. Il ne s’agit cependant là que d’une dépendance du πρότερον προς ήμάς, autrement dit une dépendance qui attend d’être complétée par une certaine objectivité. Tout cela étant dit, on est en droit d’espérer que l’étude susmentionnée contribuera à résoudre, ou du moins à définir, les questions fondamentales de la science empirique. Les questions dernières ne sauraient en effet jamais être résolues empiriquement (sinon elles ne seraient pas « dernières »), elles se fondent au contraire sur le positionnement de notre pensée face à l’objet. La saisie de cette relation est du ressort de la réflexion logique, laquelle doit s’orienter simultanément selon les possibilités et les limites du rapport forme-matière instauré par la connaissance pénétrant logiquement son matériau. Nous verrons comment les questions de la possibilité de la connaissance en général, de la saisie catégoriale des contenus et enfin de la séparation des moments subjectifs et objectifs dans la connaissance (dont dépend également la distinction bien connue entre catégories constitutives et réflexives), lorsqu’elles sont appliquées à la linguistique, placent toutes de façon similaire la problématique en question dans un éclairage autre que celui auquel on s’est habitué dans les sciences naturelles. Rien ne peut être créé sans recours à une méthode critique et à un matériau linguistique, que ce soit objectivement pour fonder des hypothèses, ou subjectivement pour traiter un matériau. Nous ne voulons faire ici ni de la logique, ni de la linguistique, mais simplement explorer les points de contact entre les deux. Comme, pour des raisons explicables, une telle entreprise n’a été que trop rarement tentée jusqu’à présent, certaines erreurs dans sa réalisation ne pourront être évitées. On ferait tort au présent travail si on le tenait pour plus qu’une pure ébauche, laquelle remplit déjà sa fonction par la pure évocation d’une possibilité. Nous n’avons pu présenter notre sujet de façon partout aussi approfondie et exhaustive que possible compte tenu de la nature de notre objet d’étude. Il est étonnant de constater combien peu l’accumulation incroyable de matériau a été accompagnée en linguistique par un traitement conceptuel. On peut trouver une certaine consolation dans le fait que la situation n’est pas bien meilleure dans d’autres domaines des sciences humaines. Les sciences psychologiques semblent particulièrement touchées par ce retard. Dans son petit livre La crise de la psychologie expérimentale, Kostyleff a ainsi montré de quel lourd poids l’accumulation d’un matériau totalement non-systématique et inutile à toute entreprise de synthèse pèse sur la psychologie expérimentale. Delbrück, quant à lui, constate dans son introduction à sa syntaxe comparée des langues indo-européennes (p. 38) que « encore maintenant, l’intérêt du linguiste se limite à ces parties là de la grammaire » (c’est-à-dire l’étude des voyelles et des formes). La même chose a été soulignée avec force par Paul Natorp en relation à la psychologie générale (Psychologie générale, p. 191).
Puisque dans les chapitres suivants le traitement de notre sujet sera essentiellement d’une teneur systématique et que nous ne pourrons mener de discussions sur les théories et les représentants historiques ou contemporains de notre science que là où cela ne gène pas la cohérence de notre exposé, il paraît opportun de présenter ici un bref aperçu de l’évolution de la linguistique, même si par ailleurs seul les éléments les plus importants à notre propos pourront être esquissés. Si nous passons outre l’évolution de la grammaire indienne – qui n’a presque pas eu d’influence en Europe et constitue donc un domaine clos sur lui-même – et que nous nous tournons vers la linguistique gréco-romaine (cf. Heymann Steinthal, Histoire de la linguistique chez les Grecs et les Romains, Berlin, 1890, 2ème Ed., 2 Vol), nous pouvons constater comment une intuition profonde pour les problèmes fondamentaux de ce domaine scientifique s’est déjà faite jour chez son instigateur, Platon, malgré le manque de données empiriques à sa disposition. Dans le Cratyle, les problèmes de la relation du langage et de la pensée ainsi que le comment et le pourquoi de la dénomination sont traités de façon dialectique et une solution y est envisagée : c’est ainsi plus qu’un hasard si l’opposition entre φύσει et θέσει qui est apparue alors, est aujourd’hui encore et en ces mêmes termes considérée comme un problème. Cela dit, l’imperfection de toute la linguistique de l’Antiquité se manifeste aussi déjà chez Platon : le mot individuel est pris comme point de départ naïf et rationaliste, le processus psychique est conçu de manière strictement parallèle avec celui du langage ou n’en est même pas distingué. L’absence complète de compréhension pour la méthode psychologico-génétique et comparative représente une lacune supplémentaire. Il est notoire que cette absence a été conditionnée par l’influence dommageable du sentiment national sur de telles questions chez un peuple comme les Grecs. Or c’est précisément dans l’application de cette méthode psychologico-génétique et comparative en sus de l’expérimentation qu’il faut chercher la raison des progrès substantiels auxquels la linguistique moderne doit son incroyable développement vis-à-vis de celle de l’Antiquité. Quand on parle de méthode génétique, on pense d’abord à la découverte de la spécificité du psychique ainsi qu’à la distinction qui s’y rapporte entre explication logico-constructive et psychologique. C’est le mérite spécifique de Wundt que d’avoir sans cesse renvoyé à cette importante distinction (cf. en particulier Psychologie des Peuples I, 1 et I, 2 : Le langage, 1911, 3ème éd., I pp. 18, 27, 31, 64, 92, 586 ; I, 224, où il combat l’intellectualisme en psychologie et la rationalisation de la psychologie vulgaire). Nous aurons toutefois plusieurs occasions de démontrer que la distinction entre psychologie rationalisante et critique ne résout pas encore le problème. Car bien que la psychologie rationaliste soit critiquable en tant que telle, il s’y cache néanmoins un noyau méthodologique auquel on ne peut échapper si la psychologie tient à rester possible en tant que science.2 Puisque les processus linguistiques continuent de se manifester individuellement ou collectivement dans le temps, l’élément temporel reste lui aussi indispensable à l’explication, ce qui a d’ailleurs conduit même d’éminents philosophes du langage à supposer que la linguistique toute entière n’est qu’une science historique (Cf. en particulier Paul : Principes de linguistique historique, 1920, 5ème édition. Le titre de l’œuvre n’est pas le seul à suggérer cette interprétation puisque, à la page 20, Paul rejette toutes les approches autre qu’historique : « On a objecté qu’il existe une autre approche que l’historique. Je dois m’opposer à cette opinion. Ce que l’on tient pour une approche non-historique mais néanmoins scientifique du langage n’est en définitive rien d’autre qu’une perspective historique incomplète – en partie par la faute de l’observateur, en partie par la faute du matériau observé. » Dans sa défense contre une attaque de Dittrich, p. 20, Paul parle même de sa « thèse » : « Il n’y a pas de différence entre science du langage et histoire du langage ». Le présent ouvrage se place sur cette question du côté du contradicteur de Paul. L’affirmation de Dittrich (cit. par Paul, p. 21), qui prétend que le livre de Paul constitue en fait un argument contre sa propre thèse, nous rappelle la page 30 de Psychologie de la pensée émotionnelle de H. Maier, où ce dernier dit de la linguistique psychologisante de Wundt qu’elle a « le même caractère » que celle de Paul, bien que Paul dans sa préface à la quatrième édition de son œuvre déclare en fait explicitement qu’il ne peut que rejeter les éléments essentiels de l’ouvrage de Wundt. La dispute semble toucher en particulier le concept wundtien d’âme du peuple (Volksseele) ; en ce qui concerne la réduction du langage à une approche historique, ils sont tous deux d’accord). Dans ce contexte, on peut encore une fois souligner que la linguistique antique, autant que nous le sachions, n’avait pas d’idée de la dimension génético-psychologique du langage. Là où elle ressentait un besoin étymologique de s’appuyer sur des formes (hypothétiques) plus anciennes, elle le faisait sans méthode ni critique et l’apparente évidence de l’interprétation valait pour elle comme raison suffisante de la vérité historique d’une forme. Quoi qu’il en soit, on ne peut enlever à l’Antiquité le mérite d’avoir posé le problème du langage (et ce problème est le commencement logique de la linguistique autant que sa fin). Il est de plus extrêmement gratifiant de retrouver un embryon de l’analyse moderne dans des écrits aussi primitifs que ceux de Denys le Grammairien. Car si notre interprétation de la détermination formelle du matériau est correcte, l’Antiquité doit être parvenue aux mêmes concepts fondamentaux et aux mêmes observations que nous dans son traitement des questions linguistiques. Les limites et les possibilités au sein desquelles les conceptions fondamentales d’un objet saisi théoriquement peuvent se mouvoir en conséquence de la structure de ce dernier sont toujours relativement limitées. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de penser l’Histoire comme une trajectoire de la science dans le sens d’un approfondissement méthodique. Le procédé de la méthode comparative, dont on ne retrouve presqu’aucune trace chez les Anciens, a commencé à être fécond seulement avec Bopp et a été fondé scientifiquement plus tôt que la méthode de l’explication psychologique. Cela s’explique par le fait que l’on était dès le début habitué à placer au centre de l’attention l’aspect du langage qui est le plus accessible à l’objectivation, c’est-à-dire son aspect sonore, alors que tout ce qui était inobservable, fluide, difficilement saisissable et lié purement au psychique ou à la logique était écarté comme n’étant pas directement utile à la linguistique. Il s’agit là d’une exclusion explicable, par laquelle chaque science commence et peut-être doit commencer, mais qui à la longue devrait être dépassée. Le mot, en tant qu’unité donnée sensible et facilement saisissable, a ainsi fourni le point de départ de toute interprétation linguistique. L’idée qu’une phrase est la combinaison d’un certain nombre de mots s’est offerte ensuite tout naturellement. Le mot, en tant que représentant principal de tout matériau linguistique (bien que ce dernier, comme nous aurons encore à le montrer, ne s’épuise pas dans le mot) offrait de par son apparence limpide de nombreuses opportunités de comparaison avec les phénomènes similaires d’autres langues et c’est ainsi qu’a débuté la méthode comparative. Le langage n’est toutefois pas simplement un arsenal de sons et de mots qui peuvent être soumis à certaines lois et classifications. Un tel usage du langage ne correspond qu’à celui qu’en fait une méthode qui n’est pas fidèle à l’essence de celui-ci. La méthode comparative n’en est d’ailleurs pas restée à cette tâche, mais a progressé vers la comparaison d’entités supérieures, ce qui s’est avéré très utile pour saisir l’essence du langage, en particulier dans les cas où il s’agissait de rassembler des exemples de types de langues fort différentes.3
Il convient pour finir de mentionner les choses suivantes en rapport à la genèse et à la méthode du présent ouvrage. Il prend sa source dans un intérêt simultané pour des questions linguistiques et épistémologiques. La critique aura donc une double cible. Cela n’est en soi pas un mal et devrait être même plus qu’utile au thème unique dont il est question ici. Nous avons cité aussi peu de littérature secondaire que possible et certainement moins que n’en a été nécessaire à notre préparation. Une raison à cela est que les principaux ouvrages de linguistique sont relativement « riches en matériau » et sont guidés par l’ambition de ne quitter à aucun prix le sol fixe du donné empirique, ce qui se manifeste clairement dans leur accumulation d’exemples pour chaque affirmation « générale ». L’étude des fondements logiques d’une science, en présuppose des détails et des généralités qu’elle n’est toutefois pas obligée de répéter ou de multiplier. Nous n’avons souvent pas pu éviter d’introduire un nouveau terme ou de donner une nouvelle signification à un nom déjà existant afin de dégager la désignation la plus adéquate pour le cadre abstrait et général de notre science. Les concepts de « systématique », de « forme », de « valeur » ou de « positionnement », qui appartiennent plutôt à la philosophie, nous ont paru être adaptés dans ce contexte. Au premier abord, notre analyse a peut-être reçu un tour spéculatif voire « scholastique » à cause de ce procédé. Cela vaut en particulier du prochain chapitre (analyse de l’objet). On peut mentionner en réponse à cela que seule l’ambition critique de découvrir les conditions fondamentales indispensables de la linguistique nous a conduit à mettre en place une telle superstructure, ou plutôt infrastructure. Que, dans le cas d’un objet qui est aussi compliqué et structuré de façons aussi diverses que le langage, on ne puisse échapper à un nombre de présupposés « simplistes » ne paraîtra pas surprenant. Un « concept » qui serait exprimé par des présupposés dans lesquels la structure de l’objet lui-même n’était pas reconnaissable n’est bien sûr jamais souhaitable. Une distinction entre l’objet – auquel tout matériau appartient – et les présupposés théoriques doit toutefois aussi toujours être maintenue. Un travail comme celui que nous avons entrepris ici doit donc s’orienter relativement à ces deux pôles. Nous ne pouvons vouloir viser ni plus ni moins que cela si nous voulons justifier et réaliser notre revendication d’une théorie fondatrice.
Aperçu des sources les plus importantes
A. En linguistique
Rud. Blümel, Einführung in die Syntax. Heidelberg 1914.
A. Dauzat, La vie du langage. Paris 1918.
—— La philosophie du langage. Paris 1917.
B. Delbrück, Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 5. Éd. 1908.
—— Grundfragen der Sprachforschung. Leipzig 1901.
—— Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Leipzig 1893.
O. Dittrich, Die Probleme der Sprachpsychologie. Leipzig 1913.
G. v. D. Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig, 2. Éd. 1901.
A. Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Bd. 1, Halle 1908.
A. Meillet, Einführung in die vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Leipzig-Berlin 1909.
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 5. Éd. 1920.
A. Pick, Die agrammatischen Sprachstörungen, 1.T. Berlin 1913.
v. Porcenzinski, Einleitung in die Sprachwissenschaft. Berlin-Leipzig 1910.
H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Berlin 1890, 2. Éd. 2 Bde.
L. Sütterlin, Das Wesen der sprachlichen Gebilde. Heidelberg 1902.
Ph. Wegener, Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens. Halle 1885.
W. Wundt, Völkerpsychologie, I, 1 u. I, 2: Die Sprache, Leipzig. 1911. 3. Éd.
—— Sprachgeschichte und Sprachpsychologie. Leipzig 1901.
Articles tirés de Indogermanische Forschungen, Indogermanisches Jahrbuch, la Zeitschrift de Kuhns, Germanisch-romanische Monatsschriften, « Mémoires de la société linguistique de Paris », etc.
B. En logique, Épistémologie et psychologie
Chr. Sigwart, Logik, 4. Éd. v. H. Maier. Tübingen 1911.
H. Maier, Psychologie des emotionalen Denkens. Tübingen 1908.
W. Wundt, Logik. 3 Bde. Stuttgart, 3. Éd. 1906.
H. Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis. Tübingen 1915, 3. Éd.
P. Natorp, Allgemeine Psychologie, Bd.1. Tübingen 1912.
A. Messer, Empfindung und Denken. Leipzig 1908.
E. Husserl, Logische Untersuchungen I u. II, 1. Halle 1913.
H. Bergson, Essay sur les données immédiates de la conscience, 1917, 17. Éd.
(1922) "Einleitung", in: Pos Hendrik, Zur Logik der Sprachwissenschaft, Heidelberg, Carl Winter, pp.1-19.