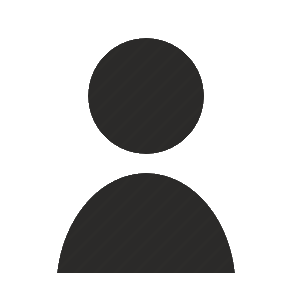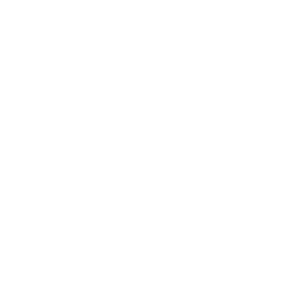This document is unfortunately not available for download at the moment.
Le langage comme fonction symbolique
Hendrik Pos
Translated by Patrick Flack
pp. 113-128
La signifique1 parle d’« actes de langage ». Elle entend par là que le langage n’est en fait rien d’autre qu’un usage linguistique qui, lui, n’existe que comme une compréhension mutuelle entre quelqu’un qui parle et quelqu’un qui écoute. Les signifistes insistent avec force sur le caractère « actuel » du langage ; selon eux, le langage n’est jamais donné indépendamment de l’acte qui en fait usage et cet acte, à son tour, est toujours donné conjointement avec un utilisateur et un but déterminé par un usage, par exemple celui d’influencer autrui. Excepté dans le cas d’exercices de langue et de conversation, on ne parle pas juste pour parler mais bien pour communiquer quelque chose à autrui. En ce sens, il est vrai qu’il n’y a pas de langage en-soi, il s’agit là d’une abstraction que l’on ne rencontre réellement que comme un moment de la relation entre locuteur, intention, auditeur, etc.
C’est le bon droit des signifistes que de souligner qu’il n’y a pas de langage en soi. Ce faisant ils s’attaquent à une conception suscitée de façon involontaire par le mot « langage », lequel donne à penser que le langage est une sorte de chose existante en-soi et détachée de tout usage. Au siècle passé, d’éminents linguistes tels que le romantique Wilhelm von Humboldt et le positiviste Hermann Paul ont précisément mis ce fait là en évidence. À l’époque, il s’agissait d’une découverte qui amenait une vision plus ample et stimulante. On s’avisait alors que le caractère inanimé du langage tel qu’on l’avait envisagé jusqu’alors n’en constituait pas l’aspect essentiel. La découverte de la vitalité du langage comme parole semblait aussi promettre une nouvelle vie aux concepts de la linguistique.
L’insistance de Humboldt, de Paul et des signifistes sur le lien entre langage et acte de langage ou entre acte, intention et effet est toutefois si partiale qu’elle est contredite en permanence par la réalité. En effet, l’objet même auquel on refuse une existence autonome et qui soi-disant ne peut être quelque chose qu’en connexion avec la réalité empirique, est justement traité de façon indépendante par la linguistique, dont le nom [taalwetenschap – science du langage] démontre bien qu’elle a pour objet le langage et le langage seulement. Ainsi, les deux positions sont correctes : le langage n’existe jamais que comme acte de langage, comme moyen orienté vers un but externe ; mais il existe également une science du langage qui ne prend pour objet ni l’acte, ni le but, ni l’effet, mais bien le langage lui-même et qui, de plus, ne pourrait être la science autonome qu’elle est si en un certain sens son objet n’était pas lui aussi donné de façon autonome. L’opposition entre le langage pris comme une chose à part et le langage considéré dans le contexte concret de l’action humaine se réduit ainsi à une opposition de point de vue : la signifique envisage unilatéralement l’acte de langage et ses effets ; la linguistique envisage en lui-même le facteur qui ne peut manquer d’apparaître en tant que moyen dans ce contexte concret, c’est-à-dire le langage.
Le langage est donc un moyen qui peut être étudié tant en lui-même qu’en relation aux buts qu’il sert. La linguistique étudie le moyen en lui-même ou, tout du moins, elle part du moyen et se demande quels buts peuvent être atteints grâce à lui. Elle ne pourrait pas faire cela si le moyen était quelque chose de contingent et d’arbitraire au regard du but qu’il poursuit. Il n’y aurait alors pas de véritable relation entre le moyen et le but : un moyen identique serait par exemple en mesure d’accomplir plusieurs buts et ce serait parfois un résultat, parfois un autre qui serait atteint. La relation entre but et moyen doit se conformer à une norme pour qu’une connaissance scientifique du moyen soit possible.
Puisque nous définissons désormais le langage comme un moyen, il faut nous occuper dans les pages suivantes des questions de sa création et de son fonctionnement. Cette démarche est hypothétique : nous ne pouvons que demander comment nous nous représentons les modalités de la genèse de ce moyen à partir du donné et des instruments conceptuels dont nous disposons. À côté de cette vision hypothétique et donc constructive, il existe une approche empirique qui répertorie et classe les ressources que met à notre disposition le langage tel qu’il se constitue dans une tradition historique.
La naissance du langage ne peut pas être observée, elle ne peut être que pensée. La question est donc ici de savoir quelles conditions ont rendu possible le langage. Qu’existait-il déjà, dans quelle nouvelle situation le langage est-il apparu et que s’y est-il ensuite ajouter ? Pour que le langage soit possible, l’homme devait déjà exister comme être de volonté et d’ambition. La volonté humaine est une condition certes nécessaire mais pas suffisante pour expliquer le langage. En sus de l’ambition, il faut une deuxième force fondamentale : l’intelligence. Ces deux forces sont données avec l’être humain : elles ne sont pas dérivables l’une de l’autre et ne peuvent pas non plus être réduites à un fondement unique. Leurs relations réciproques se laissent mieux décrire que leur existence séparée. Telles qu’elles apparaissent dans l’expérience, elles peuvent d’ailleurs entretenir des relations variées. L’ambition, prise en elle-même, reste sans direction, sans fondement, aveugle. On ne peut comprendre pourquoi elle devrait exister plutôt que non, elle est contraire à l’intelligibilité et à l’entendement. Mais, prise en elle-même, l’ambition est aussi une abstraction qui n’est jamais réellement donnée. Dans la réalité nous ne trouvons en effet que des ambitions particulières qui sont toujours liées à l’intelligence ; il ne peut y avoir d’ambition déterminée qui ne s’oriente vers un but et son horizon. Une ambition guidée par un but n’est plus aveugle : elle fait face à son but. L’intelligence qui définit ce but n’est ici encore que subsumée à l’ambition ; elle ne fait que guider l’ambition vers son but, sans lequel celle-ci ne peut conduire à l’action. Définir un but est la fonction la plus primaire et la plus simple de l’intelligence. Mais l’intelligence peut aussi aider à la réalisation d’un but après l’avoir défini, elle peut aider à surmonter la distance qui sépare l’ambition du but à l’horizon : l’intelligence semble donc autant en mesure de définir un but que de sélectionner les moyens. Bien qu’elle propose à la volonté les moyens et les chemins à emprunter, l’intelligence n’équivaut pas elle-même à la volonté. Elle apparaît certes à l’origine entièrement au service de la volonté, mais elle n’est pas liée à elle de façon nécessaire, elle est libre par rapport à la réalisation des buts et la mise-en-œuvre des moyens qu’elle-même préconise à la volonté. C’est sur la base d’une connaissance des moyens qui permettent d’élaborer ou d’obtenir quelque chose que l’intelligence voit comment quelque chose peut être accompli. Cette connaissance rend possible, mais n’induit pas l’emploi de ces moyens. Le champ de l’ambition est limité par la manière dont les buts, les moyens et les chemins à suivre sont mis à sa disposition par l’intelligence.
Le langage est donc un des moyens que l’intelligence emploie afin de rendre possible la réalisation d’une ambition et grâce auquel, de plus, de nouveaux buts sont proposés à la volonté. Que ceci constitue l’origine du langage, on ne peut l’établir qu’hypothétiquement à partir du fait que : 1° le langage semble être utile à l’ambition et que l’accès au langage et l’accès au domaine des buts dépendent l’un de l’autre ; 2° les éléments du langage peuvent être compris comme une série de groupes de symboles de complexité croissante qui se présentent comme la continuation des moyens qui étaient à la disposition de la volonté avant l’apparition du langage.
Le langage n’est en effet pas le premier moyen que l’intelligence ait inventé au profit de la volonté. Un être psychophysique précède le langage : le corps. Il n’est pas nécessaire de croire la métaphysique de Schopenhauer et de concevoir l’organisme dans son entier comme une manifestation de la volonté pour reconnaître le caractère médiateur et soumis à la volonté des organes particuliers que sont les yeux, les dents ou les mains. Similairement, on peut constater qu’à chaque organisme dans son ensemble correspond une ambition spécifique, qui n’est pas guidée par une représentation consciente et qui contribue à maintenir son unité. Alors que les besoins liés à la conservation de l’organisme s’expriment dans des organes déterminés, les organes des sens constituent eux des formes de connaissance qui sont liées à l’organisme et qui produisent le matériau nécessaire à l’existence. Le langage au sens large a dû exister avant la parole, qui n’a pu commencer qu’avec l’apparition de l’organe du son. En tant que moyen pour réaliser des buts, le langage constitue la continuation des moyens fournis directement par l’organisme, c’est-à-dire les organes. Là où il n’apparaît pas spécifiquement comme parole, le langage doit être compris comme la continuation des organes de la vue et de l’action par excellence, les yeux et les mains. Ceux-ci possèdent la fonction la plus différenciée dans le système opératoire de l’organ-isme. L’œil n’est pas seulement l’organe de la reconnaissance par excellence : la vue possède également un pouvoir originel de signification et, avec le geste de main, elle constitue un moyen pour transmettre la volonté. La main ne dispose pas uniquement de la fonction du toucher, qui sert de connaissance approximative ; elle est en même temps un moyen pour prendre, retenir, soutenir. En plus de toucher, elle peut, guidée par l’œil, saisir et atteindre. Grâce à cette coopération de la main et de l’œil, l’homme est en mesure de s’orienter vers des buts hors de son entourage immédiat ; en plus d’être un organe de connaissance, la main constitue un moyen pour atteindre des buts éloignés et aspirer à d’autres encore plus lointains. Elle est la ressource originelle de l’organisme et, en même temps, de la main part l’initiative vers d’autres moyens qui la dépassent elle-même. Tout acte de fabrication prend sa source dans la main, la technique poursuit à plus grande échelle ce que la main a commencé. Les objectifs que cette dernière ne peut réaliser ont ainsi besoin d’elle pour créer des moyens qui la complémentent et s’y substituent là où elle n’est pas suffisante. Ici également, l’intelligence est nécessaire pour déclencher l’emploi des moyens. Le complément artificiel le plus primaire de la capacité préhensive de la main est exhibée déjà par les anthropoïdes de W. Köhler : il s’agit de l’idée qu’un bâton puisse servir de prolongement de la main pour atteindre de la nourriture et, à un stade supérieur, qu’un autre bâton puisse servir pour encore prolonger le premier. Ici l’intelligence inventant des moyens ne se limite déjà plus à prolonger inconsciemment des organes particuliers. Chez l’animal déjà, elle produit avec les organes, dans des situations favorables, des outils qu’il ne serait pas possible de créer sans au moins une lueur d’intuition quand au matériau dont ils sont tirés.
L’outil est donc un moyen que l’intelligence découvre et que la main contribue à fabriquer. L’outil élargi le champ d’action des organes, il s’y substitue et les soutient ; il surmonte les limitations auxquelles le corps se trouve confronté ; il vise et obtient plus de force, de rapidité et d’endurance, ainsi qu’une économie d’énergie et de temps et un dépassement de tous les obstacles auxquels le corps et ses organes se trouvent confrontés.
Le langage est lui-même aussi un outil qui permet de dépasser les limites initiales des possibilités humaines. En contraste avec tous les instruments qui servent à conquérir la nature et grâce auxquels l’homme, en tant que créature intelligente, s’affirme et s’enrichi face à la nature morte, le langage est un instrument au service des rapports entre les hommes, c’est-à-dire de la compréhension mutuelle. Les moyens créés par l’intelligence au service de la volonté se divisent donc en deux groupes : ceux qui sont dirigés vers la nature et ceux qui rendent possible et encouragent la compréhension humaine. Cette division s’opère bien sûr à partir d’un tronc commun ; les instruments dans l’un ou l’autre sens ne peuvent à l’origine pas être pensés de manière vraiment distincte. Aussi convient-il ici de se demander si une structure commune sous-tend ce lien génétique. Une telle structure existe : ce sont les mêmes organes qui servent d’outil, qui servent à créer des outils et qui donnent lieu à la compréhension. La main, qui est à l’origine de toutes sortes d’instruments, est aussi à l’origine du langage. Dans les deux perspectives, l’outil apparaît parce que l’organe est insuffisant. Ce résultat négatif et l’insuffisance des moyens donnés avec le corps deviennent quelque chose de positif parce que l’intelligence ne s’en contente pas. L’intelligence surmonte l’échec de ses tentatives dans deux directions : dans le sens de la nature, par le prolongement et l’accroissement artificiel des ressources (la technique) et dans le sens de la société humaine, par la compréhension mutuelle dans le langage. L’acte de langage originel est le geste, lequel prend sa source dans le mouvement de la main. La main tendue qui n’atteint pas son but se convertit en une main qui réalise un acte de langage ; alors qu’en soi elle reste un organe qui n’atteint pas son but, elle est comprise et finalement se comprend elle-même comme une main qui indique. Avant le langage, il y a donc le geste et, comme toute première origine du langage, le geste de la main tendue. Sans l’intelligence, ce geste ne pourrait ni être reconnu comme une main qui indique, ni se connaître et se vouloir lui-même comme tel.
De même que l’acte de tendre la main n’équivaut pas à indiquer quelque chose, mais est converti à cet emploi, l’acte d’indiquer ne revient pas à montrer. Une main indiquante ne se montre pas elle-même, elle montre plutôt qu’elle n’atteint pas ce vers quoi elle est tendue et elle se mue alors en une indication de l’objet désiré. L’intelligence qui fonde la communication saisi l’aspect négatif du geste de la main indiquante, mais elle l’interprète avec sympathie et lui attribue alors la signification d’une demande d’aide. Parce qu’elle est comprise avec sympathie, la main se transforme d’un phénomène négatif en un phénomène positif ; interprétée comme une demande d’aide, elle reçoit une nouvelle chance de succès. La main interprétée comme acte de langage ne se comprend tout d’abord pas elle-même comme étant déictique : elle ne se connaît que comme main tendue, elle continue à vouloir obtenir ce qu’elle désire et éprouve sa propre incapacité à atteindre son objet désiré alors même qu’elle se tend vers lui. Il faut un second acte de l’intelligence pour que la main découvre comment elle est perçue et pour qu’elle obtienne alors une connaissance d’elle-même et de sa fonction déictique. Seul ce savoir propre lui fait découvrir le moyen pour dépasser son incapacité à atteindre son objet. Ce moyen est la compréhension sympathique de l’autre. Se sachant compris, l’organe du toucher peut donner un nouveau sens à son échec, il peut être interprété comme déictique.
La main déictique s’élabore donc à partir de l’échec de la main tendue, qui est réinterprétée de façon positive et se découvre elle-même comme étant déictique. Initialement, seule une main qui n’atteint pas son but est déictique ; la main qui atteint son objet rempli adéquatement sa fonction dans l’acte d’atteindre l’objet et ne reçoit dès lors pas d’autre fonction, telle que l’indication. Le fait d’atteindre son objet fait s’assimiler entièrement l’organe en question à sa fonction, car un but qui est atteint par des moyens déterminés ne soulève pas de nouvelle question quant aux moyens mis en œuvre. Toute nouvelle fonction qui est découverte par l’intelligence peut toutefois s’émanciper de la situation initiale dans laquelle elle a été découverte. Au début, seule une main qui n’atteint pas son objet se transforme en une main qui indique : l’indication est d’abord le moyen par lequel l’échec de la main tendue est remplacé. Après avoir apporté sa solution au problème, l’indication persiste cependant, pour ainsi dire, comme une puissance libre. De la sorte, une fois découverte comme moyen secondant l’incapacité d’atteindre quelque chose, l’indication peut aussi apparaître là où cette dernière fonction s’accomplit bel et bien. Dès ce moment, atteindre ou indiquer un objet deviennent des fonctions indépendantes l’une de l’autre : on peut indiquer également ce que l’on pourrait atteindre. Le problème initial et sa solution restent utiles dans d’autres domaines. Après être venu en aide à l’acte d’atteindre quelque chose, la fonction déictique s’en sépare et permet d’indiquer tout ce que la main peut atteindre, indépendamment du fait que la main atteigne l’objet ou non. On assiste ainsi aussi à une extension de la sphère de l’intelligence et à un refoulement de la volonté : ce que l’on désir atteindre, on peut simplement l’indiquer ou se le laisser indiquer. C’est le début d’une compréhension où il ne s’agit plus seulement d’atteindre et d’obtenir.
Nous avons analysé soigneusement le premier acte de langage accompli par la main, dans la mesure où sa genèse renferme le principe de toute langue des signes supérieure. Lorsque la main qui n’atteint pas son objet est comprise et se sait comprise comme étant déictique, sa fonction première se trouve restreinte, d’abord de façon contraignante, puis par libre choix : on ne saisit pas ce que l’on indique, on ne se l’approprie pas, mais on le rend accessible aux autres. Le geste déictique, qui n’est plus au service de ce que l’on veut saisir, crée de la communauté. On peut indiquer toutes les choses que l’on peut saisir et bien plus que cela. Une compréhension mutuelle s’établit avec autrui grâce à l’indication, au début dans un rapport de demande d’aide, puis dans un sens plus libre.
Le geste déictique est encore limité dans ses possibilités, bien qu’il dépasse le domaine initial du simple geste de tendre la main. Il ne permet la compréhension que de ce qui peut être indiqué. La main qui indique demeure liée de façon externe à son objet. En indiquant, elle fait une distinction entre le proche et le lointain, l’ici et l’ailleurs, mais elle ne distingue pas encore la manière dont elle indique. L’acte linguistique de l’indication attribue cette dernière fonction à l’œil, à l’observation : la main qui indique est insuffisante pour déterminer les particularités de l’objet observé, elle ne peut que l’indiquer. Le geste déictique ne peut dépasser la distance entre lui et l’objet qu’il indique ; celui-ci lui demeure extérieur, quelque soit la manière par laquelle il s’y rapporte.
Cette limitation de l’indication peut être transcendée quand la main n’est plus étrangère à l’objet présent, mais le fait apparaître elle-même, grâce au mouvement particulier qu’est le geste mimétique. En imitant, la main comble le défaut qui caractérise le lien entre ce qui indique et ce qui est indiqué ; elle ramène ce qui est indiqué à l’indication elle-même. Le geste devient alors à la fois déictique et préhensif, autrement dit il donne lieu à une synthèse, à partir de la distinction initiale entre préhension et indication. Cette synthèse, le geste mimétique, constitue un nouvel élargissement des possibilités de la main sur la base de l’intelligence. Ce geste engendre une représentation de l’objet visé, indépendamment de l’observation. À l’origine, il a émergé là où l’indication ne suffisait pas, là où une observation de l’objet visé ne paraissait pas possible, et la main cherchant à indiquer tournait en rond sans que son acte d’indication trouve d’accomplissement. Lors d’un geste déictique, l’objet est déterminé comme une partie ou un morceau de l’espace, ce qui est indiqué se trouve quelque part. L’imitation quant à elle transforme ce quelque part en un « ici », non pas de telle manière cependant que cet ici soit autre chose que la place initiale de la préhension, de l’atteinte et de l’indication ; compris littéralement, le « ici » du geste mimétique n’est justement pas ici ; le « ici » reçoit un nouveau sens via l’imitation, sens qui coïncide avec celui du geste. La personne qui interprète littéralement le « ici » du geste mimétique de la main ne peut que mésinterpréter cette imitation comme une simple présentation de la main. En tant qu’imitation accomplie « ici », l’objet visé ne se trouve en un sens plus dans l’espace où on cherchait à l’indiquer ; mais en même temps, il ne se trouve « ici » que comme imitation. L’imitation se défait donc de la détermination spatiale de son objet ; elle passe à une détermination générale, une image de l’objet indifférenciée au point de vue du temps et de l’espace, autrement dit elle passe à son essence. En résumé, l’acte de langage mimétique ne fournit pas seulement la possibilité d’abstraire quelque chose du donné spatial, mais il n’en rend pas pour autant possible la projection d’objets observés dans l’espace. Initialement, l’imitation doit à nouveau s’en tenir à des objets que le geste déictique ne peut pas trouver. Mais, tout comme l’indication, l’imitation peut devenir une imitation libre – c’est-à-dire une projection – d’objets qui n’ont pas été appréhendés et qui n’ont pas encore été indiqués. Tout comme l’indication est un acte préhensif émancipé – puisqu’on peut indiquer plus de chose que l’on ne peut atteindre –, l’imitation est une indication qui dérive en premier lieu d’une impossibilité d’indiquer, mais qui ensuite amène à dominer le champ de ce que l’on peut bel et bien indiquer : l’imitation dépasse son origine de tout côté en tant que moyen auxiliaire. Il ne s’agit plus d’indiquer quelque chose dans un espace déterminé, mais de montrer un être possible qui se trouve ici ou là, ou qui tout du moins pourrait l’être. Le geste mimétique conduit à la fantaisie pure, laquelle constitue l’espace le plus large du geste ; de même que le possible contient le réel comme une partie, de même l’objet libre contient l’imitation, l’imitation contient l’indication, et l’indication contient la préhension.
Le langage a donc inventé les symboles tour à tour pour ce qui ne se laisse pas atteindre, pas indiquer, pas imiter dans l’espace. Une nouvelle phase du geste est apparue à chaque fois que la précédente atteignait sa limite et échouait dans son but ; à chaque fois l’intelligence a su apporter un sens positif au résultat négatif. Après le geste mimétique apparaît encore le geste signifiant ou symbolique au sens restreint du terme. Le geste signifiant ou le signe n’évoquent plus un contenu qui possède une similarité externe avec quelque chose d’observable ; le signe est bel et bien lié à une observation, mais sans représenter celle-ci. C’est un véhicule de la sphère abstraite des concepts, lesquels sont la véritable œuvre de la raison. Un geste peut ainsi représenter l’objet qu’il vise de manières différentes, de façon soit plus complète, soit plus suggestive. Moins la représentation est complète et plus elle est schématique et suggestive, moins il y aura de coïncidence externe entre le geste et la signification. La coïncidence est la plus faible dans le cas des significations abstraites puisque le geste reste toujours lié à des organes qui s’expriment dans l’espace. L’abstrait ne forme pas pour autant un monde à part qui ne pourrait être exprimé par des gestes spatiaux et qui dès lors ne pourrait être visé avec des gestes que par une coïncidence contingente et arbitraire. La grande différence entre un geste et sa signification abstraite ne vient pas du fait que la volonté, afin d’exprimer l’abstrait, emploie autant que faire se peut des moyens spatiaux et qu’elle passe outre tout lien entre geste et signification : la distance entre les deux n’est pas le résultat d’une incompatibilité que l’intelligence s’efforce de réduire à un lien assez faible. Cette distance est devenue si grande parce que le geste finit par adopter la signification abstraite. Tout geste ou signe qui exprime des contenus abstraits possède une histoire antérieure au cours de laquelle il a possédé une fonction plus représentative que symbolique. Ce n’est pas la signification abstraite, pensée comme quelque chose d’existant toujours en elle-même, qui cherchait et a trouvé par hasard un signe capable de l’exprimer ; la signification abstraite n’était pas déjà ce qu’elle est devenue, après qu’elle a été fixée et exprimée par un geste ou un signe. L’évolution ne s’est pas déroulée comme si la signification abstraite avait finalement trouvé un geste, par ailleurs peu adéquat. Bien au contraire, elle est partie du geste lui-même. L’évolution du geste vers sa propre fonction symbolique s’est accomplie comme celle de la main préhensive qui devient l’expression d’une indication en tant que geste et ce n’est pas à l’inverse, l’indication qui trouve dans la main préhensive un moyen adapté à son expression. Le même geste, qui d’abord était une représentation, abandonne en bien des cas sa fonction représentative et passe à une fonction symbolique. L’arbitraire dans la relation entre geste et signification abstraite ne subsiste que tant que l’on considère la relation entre les deux en elle-même et qu’on ne fait pas attention aux significations que ce geste ou signe a traversé avant d’obtenir sa fonction symbolique. Exprimer ce qui n’est pas observable constitue la plus haute et la plus importante fonction du signe linguistique et cela mène de façon contingente à vouloir examiner le lien entre symbole et signification justement là où il est le plus intériorisé : l’abandon du lien observable entre signe et signification est juste une condition négative dont dépend la possibilité d’une fonction supérieure et plus large du geste.
Il est possible de tout exprimer dans la langue des signes, même ce qui est abstrait. Cette langue offre une analogie parfaite avec le langage parlé, lequel traverse les mêmes phases que la langue des signes (déictique, mimétique-analogique et symbolique) et n’est pas plus riche qu’elle en termes de possibilités intellectuelles. L’organe de la parole n’est pas la main, mais la bouche et le palais. Le son produit par articulation est d’une autre sorte que le geste, mais du même genre. Alors qu’on peut différencier l’usage de la main en technique d’une part, et en compréhension d’autre part, le son, de par son genre, sert plutôt à la compréhension. L’action et les possibilités d’action du son de la langue sur la nature sont négligeables : la voix n’offre pas de moyens comparables à ceux de la main pour contrôler la nature. Tout au plus dans les conceptions magiques de la parole chez les peuples primitifs attribue-t-on au son comme une puissance sur les choses. Mais la magie est un vestige obsolète qui ne se mue pas en technique. Considérons encore brièvement les phases de la langue parlée. La phase la plus inférieure est celle de l’unité immédiate entre son et signification – Wundt parle dans ce cas de geste-sonore : l’état subjectif d’un individu se manifeste dans le son. Moyen et but sont ici encore à peine séparés. La langue obtient une fonction objective et médiatrice seulement lorsqu’elle indique quelque chose d’autre, au sujet duquel le locuteur et l’auditeur cherchent à se comprendre. Dans ce cas, le son apparaît comme une imitation, de la manière la plus simple en tant qu’imitation d’un autre son. Mais de même que la réalité ne peut être imitée dans toutes ses relations par des gestes, elle ne peut l’être d’autant moins par des sons. Initialement, les sons du langage représentent mimétiquement ce qui constitue en soi aussi un son, puis ils représentent ce qui produit un son et enfin ce qui ne produit aucun son. Cette dernière représentation constitue la fonction symbolique du mot. Ici aussi la situation est semblable à celle du geste : si l’on part d’une langue complètement développée, le lien entre un mot déterminé et sa signification est incompréhensible. Seule la familiarité d’un mot nous suggère une intuition quant à sa signification, mais cette intuition est limitée aux mots de la langue à laquelle on est habitué : ce fait est à comprendre subjectivement et psychologiquement, il ne constitue pas une raison pour le lien entre mot et signification. Le mot qui possède une fonction symbolique a toute une évolution, comme c’est le cas d’un geste. Si on explore cette évolution, on découvre toujours qu’un mot a servi sur un plan inférieur et que c’est par extension et en devenant abstrait qu’il est passé à la fonction symbolique. L’étymologie nous apprend toujours qu’un mot a traversé des phases inférieures avant d’assumer une signification abstraite. Un signe qui s’est purgé de l’observation n’a rien perdu de son observabilité, il ne s’est pas effacé ou estompé, il a juste échangé sa propriété observable limitée pour quelque chose d’autre, c’est-à-dire un caractère compréhensible. Ce faisant il ne s’est toutefois pas détourné de son monde originel, il s’en est seulement distancié de façon à obtenir sur celui-ci un contrôle nouveau et supérieur. Les symboles abstraits ne forment donc pas un monde de significations différent du monde observable. Leur origine trahit qu’ils dérivent du monde des signes de la lange primaire et qu’ils sont liés à l’observation. Les catégories de la raison, dont Kant a démontré qu’elles nous « rendent possible » le monde sensible, c’est-à-dire que notre connaissance, notre action et nos sentiments peuvent grâce à elles donner forme au monde, constituent un cas similaire. Tous les symboles abstraits de la langue sont ainsi « transcendantaux » au sens large par rapport à l’observation empirique : ils se purgent d’elle pour en faire tout ce qu’il est humainement possible d’en faire. La raison et le langage informent la réalité d’une manière spécifiquement humaine.
Le symbole a une tendance à renier son origine limitée. Tout symbole s’efforce, dès qu’il devient un moyen de communication, de se défaire de son caractère symbolique et de devenir entièrement réel. La valeur que le symbole s’efforce ainsi d’atteindre ne serait atteignable que si celui-ci fonctionnait de façon infaillible. Cela n’est cependant jamais le cas, le symbole ne sera jamais un phénomène naturel ; il demeure dépendant d’une intention qui doit être comprise et d’une compréhension à laquelle il contribue lui-même
Ainsi, l’emploi de moyens et de symboles fait que la volonté primaire se retrouve au second plan, au profit de la compréhension. Le moyen, d’abord coincé entre son point de départ et son but est libéré en ce sens qu’il peut lui-même devenir un but, alors que l’intelligence demeure impassible. Les symboles linguistiques ont certes été créés comme des moyens au service de la volonté et de l’intelligence. Mais ils se transforment en quelque chose de plus, comme les maillons d’une chaîne dont on ne voit pas la fin. En science et en art, le moyen est détaché de la volonté primaire qui l’a créé par le concept du symbole et le libre déploiement du potentiel symbolique. L’intelligence servile se mue en un concept omniscient qui comprend sa propre origine et déploie sa liberté dans la beauté et la vérité.
- Cassirer Ernst (1923) Philosophie der symbolischen Formen I: Die Sprache, Berlin, Bruno Cassirer.
1 Théorie sémiotique proposée dans les années 1890 par Victoria, Lady Welby (1837 – 1912) en lien avec les idées de C. S. Peirce. Reprise au Pays-Bas par le « mouvement signifiste néerlandais » (Nederlandsche Signifische Beweging), lequel comptait des figures telles que le psychiatre Frederik van Eeden (1860 – 1932) et le mathématicien L.E.J. Brouwer (1881 – 1966).