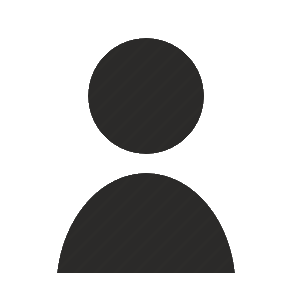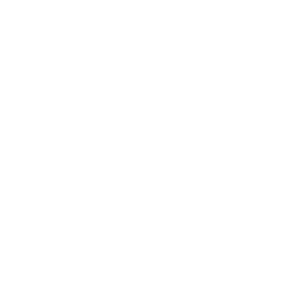This document is unfortunately not available for download at the moment.
Phénoménologie et linguistique
Hendrik Pos
pp. 193-206
La direction que le mouvement phénoménologique a donnée à la recherche philosophique est, comme on le sait, contraire à celle de la science empirique : tandis que celle-ci établit l’image objective et constructive des données de l’expérience, le phénoménologue demande à connaître l’image directe et vécue de cette expérience même, image qui est antérieure à la construction et à la théorie et qui est écartée d’emblée là où la science entre dans ses droits.
Le fondateur de la phénoménologie a ouvert les yeux des philosophes et des savants sur la réalité de cette connaissance originaire, qui non seulement précède la théorie, mais en est le fondement. Il a démontré l’existence d’un savoir apriorique pour tous les domaines de la science. Cet a priori n’est pas formel, mais matériel : enveloppé dans la conscience préscientifique de tous les sujets humains, il contient les présuppositions qui tracent d’avance les cadres dans lesquelles la science de chaque domaine doit se développer, même si, par sa technique, elle arrive à les briser.
Ce faisant, Husserl a enrichi les recherches sur la connaissance d’un domaine singulièrement important : celui d’une vision du monde qui est à la base de tout savoir scientifique et que nous pouvons connaître grâce à une réflexion sur la subjectivité qui est le point de départ de tout savoir ultérieur. Cependant la valeur de cette découverte ne saurait être limitée à ceci. Elle éclaircit en même temps la nature de la conscience qui porte en elle ce savoir originaire : la conscience naturelle. Or, la phénoménologie démontre que la conscience naturelle n’est pas le champ des associations arbitraires et des idées vagues ainsi qu’elle est présentée par les théories qui prennent leur point de départ dans la science et qui ne traitent la conscience préscientifique que rétrospectivement, comme un commencement, imprécis en lui-même, et dont la nature consiste à être dépassée par la conscience scientifique. Husserl a démontré que la subjectivité originaire contient une image du monde des choses, qui peut être étalée par la réflexion. Aussi, la réflexion n’y trouve rien de vague, mais des contours précis, des intentions claires, d’une validité qui ne se mesure pas par les critères de la science.
En tournant l’attention vers cette réalité trop méconnue par les savants, qui, poursuivant leur but d’objectivité, sont presque forcés de s’en écarter, la phénoménologie a fait davantage qu’étendre le domaine des recherches épistémologiques : en révélant la structure de la conscience originaire, d’un côté elle a rattaché celle-ci à la conscience scientifique, dont d’autre part elle a abattu l’absolutisme qui prétend que la seule constitution du monde se fait par la science. Le phénoménologue est plus près de la réalité concrète quand il rejette cet absolutisme : il reconnaît la tension entre la réalité originaire et celle qui est scientifiquement établie. Cette tension lui prescrit une souplesse dans les concepts qui puisse satisfaire aux exigences de la science et de la subjectivité en même temps. En effet la phénoménologie n’attaque pas l’image scientifique en faveur de l’image originaire des choses : si elle se refuse à accepter comme unique et absolue l’image scientifique, c’est au service de l’idéal philosophique d’une connaissance aussi totale que possible et qui n’exclut ni l’objectif en faveur du subjectif ni inversement. C’est ainsi que la phénoménologie tend à éviter aussi bien le dogmatisme de l’image scientifique que celui d’une connaissance vécue qui voudrait être absolue.
On connaît les tentatives qu’ont entreprises des penseurs inspirés par la phénoménologie pour rétablir dans ses droits les réalités négligées par l’objectivisme d’une théorie, et comment ces penseurs ont fait valoir la description d’intuitions originaires contre des explications qui paraissaient effacer trop de données. En mathématiques, c’était la revendication des bases d’intuition contre le formalisme constructiviste, en psychopathologie la fidèle description des réalités vécues contre des tendances explicatives, en esthétique le rétablissement de la beauté vécue contre les explications psychologiques d’une part et les déductions spéculatives de l’autre. En biologie, l’essence de la vie, originairement accessible à l’intuition, devait être maintenue en face des réductions physico-chimiques. Nous nous dispensons de continuer ici cette énumération. Mais remarquons, qu’en général les sciences humaines ont un intérêt tout particulier à l’application du point de vue phénoménologique. Cet intérêt repose sur le fait que l’homme est déjà l’objet d’un savoir avant toute science par le fait de la conscience qu’il a de lui-même et par la façon dont il se conçoit : la science qui vient se surajouter rencontre chez lui une connaissance déjà présente. Cette rencontre donne lieu à des tensions d’un ordre particulier, puisqu’ici l’objet en question est en même temps le sujet. Il est bien vrai que dans la connaissance de la nature, l’intuition originaire rencontre la construction scientifique. La discussion entre les deux ne saurait se réclamer de l’appui de l’objet lui-même. Mais, dans le cas de la connaissance de l’homme, c’est bien le sujet-objet qui intervient. L’homme qui est l’objet de la controverse entre la connaissance originaire et la connaissance scientifique, est en même temps le sujet qui prend position, et c’est là la complication toute particulière dans la tension entre la connaissance primaire et la connaissance scientifique. Nous voudrions illustrer ce thème par quelques considérations sur la connaissance linguistique. Nous acceptons une connaissance de la langue, établie par la science linguistique. Cette connaissance concerne un objet, qui est connu d’une autre façon : de façon immédiate, par le sujet linguistique qui est chaque être humain. Cette connaissance, tout en étant pré-linguistique, est une véritable connaissance : le sujet parlant ne se sert pas de la langue comme son corps se sert de la circulation du sang : il en a une certaine conscience. Cette conscience et la connaissance linguistique s’écartent l’une de l’autre. Est-ce qu’elles s’écartent de façon à s’opposer ? Est-ce que la connaissance linguistique est indépendante par rapport à la connaissance pré-linguistique ? Sinon, quelle est la limite de l’écart entre les deux, et en quoi consiste leur base commune ?
Pour répondre à ces questions, il faudra se placer dans la conscience linguistique originaire et étudier l’écart qui se produit à l’intérieur de celle-ci et qui est l’origine de la science linguistique. La voie opposée est plus facile : me plaçant dans la science que je trouve dans un état déjà avancé, c’est rétrospectivement que je caractérise la conscience originaire : je dirai que celle-ci ne sait pas encore tout ce que sait la science linguistique. Ainsi vue, la conscience originaire paraîtra comme toute négative, ou tout au plus comme un minimum qui s’est accru grâce au savoir linguistique. De cette façon, je ne toucherai pas à ce qu’il y a de substantiel et de déterminant qui se maintiendra, sous une forme modifiée, dans l’évolution de la connaissance linguistique. Il faudra donc revenir en arrière et commencer par le vrai commencement.
Ce que je sais, comme conscience linguistique originaire, c’est que je dispose de mots pour m’exprimer. Par les mots il y a un lien avec le monde des choses puisque je peux les nommer et avec celui des personnes puisque je peux communier avec elles. Les mots appartiennent aux choses, ils les révèlent, c’est grâce à eux qu’il y a intimité avec les choses. Les autres emploient les mêmes mots que moi ; en même temps le contact avec chacun se fait par sa façon propre de parler. D’ailleurs les mots sont au service de ce contact personnel ; l’entente est confirmée par l’échange de la parole plutôt que créée.
Ce qui distingue ce témoignage subjectif et vécu de l’observation scientifique, c’est l’attitude active d’où il dérive : le sujet linguistique, tout en se rendant compte de sa fonction, ne s’est pas scindé. Il énonce sa réalité vécue, sans l’observer en spectateur. Aussi, rien ne se perd dans ce qui est énoncé de cette réalité. D’autre part, rien n’y rentre qui dépasse le cercle fermé qui protège la conscience originaire. Celle-ci, dans sa simplicité, est trop sérieuse pour être curieuse. Vouer plus d’attention aux réalités de la parole lui paraîtrait exagéré. Cependant, l’extension de l’horizon de la conscience originaire se produit d’une façon toute naturelle. Mais cette extension est menée par une nouvelle attitude de la conscience, celle de l’observation. Or, observation et activité originaire sont tout à fait opposées. L’activité linguistique est substantielle, elle fonctionne sans se connaître. À la voir procéder, on croit observer un prolongement de cette nature inconsciente qui produit non seulement des êtres vivants, mais aussi des collectivités et des solidarités. Personne n’a institué les significations de ces mots ni les règles de leurs multiples emplois, et pourtant les sujets parlants, après un court apprentissage, s’en servent d’une façon qui correspond à leur tendance vers l’entente. Ce procédé n’a rien de réfléchi ni de convenu d’avance. La conduite du plus simple sujet parlant est caractérisée par une sûreté presque instinctive qui est propre aux actes commandés par la nature. La conscience qui accompagne cette conduite n’a pourtant rien d’un savoir : pour qu’il y ait savoir au sujet de la réalité linguistique, il faut qu’il y ait question et observation. Et pour qu’il y ait extension de l’horizon, il faut que le sujet linguistique change d’attitude et que de sujet actif il devienne sujet observateur.
La possibilité d’interrompre l’attitude active et de la remplacer par celle de l’observateur est propre à l’esprit humain. Nous pouvons disposer de l’une et de l’autre, sans pouvoir les appliquer en même temps. C’est à l’entrée en jeu de l’attitude d’observateur que la connaissance linguistique doit son origine. Pour pouvoir se déployer librement et d’après sa nature, elle abandonne la sûreté instinctive et exclusive de la conscience originaire en admettant, sur la base de l’observation, des possibilités qui sortent du cadre des données naturelles. Tout ce que l’observation ajoute à la conscience linguistique originaire, est étranger à celle-ci en ce sens qu’elle n’en a pas besoin pour fonctionner intégralement et qu’elle refuse d’en intégrer n’importe quel élément dans son activité. Si la conscience linguistique primitive admettait la relativité qu’introduit le savoir, elle perdrait sa sûreté et ne saurait plus agir. La conscience primaire se révèle comme la négation de toutes les découvertes de l’observation, comme celle-ci se révèle la négation de toutes les certitudes de l’activité originaire. L’extension par l’observation linguistique a lieu dans plusieurs directions. Il y a premièrement la découverte du caractère «arbitraire» du mot par rapport à sa signification. La preuve en paraît être donnée par le fait de l’existence d’autres langues. Les autres langues ayant toutes les mêmes droits à nommer les choses comme elles le veulent, la prétention de ma langue maternelle de posséder les vraies dénominations ne pourra se maintenir devant l’observation. La conclusion paraît inévitable. Mais elle l’est seulement pour la conscience de l’observateur, et nullement pour celle du sujet parlant : pour celui-ci la propre langue de chacun continue à représenter l’accès immédiat aux choses comme avant. Il y aura ainsi deux aspects, exclusifs l’un de l’autre : l’observateur, en tant que tel, d’un point de vue détaché de la conscience originaire, maintiendra la valeur égale de chaque système de mots par rapport à leur expressivité. D’autre part, dans la réalité concrète, cet observateur, de même que la conscience non informée, persistera dans l’attitude active qui ne sait rien de la pluralité des systèmes de mots ni de l’égalité de leur arbitraire. Ce qui revient à dire, que c’est au dedans de certaines limites seulement et non pas de façon absolue que vaut le point de vue de l’observateur : les limites sont là où l’observateur devient sujet parlant. L’attitude d’observateur n’abolit pas l’attitude active. Aussi la première n’a-t-elle pas de caractère absolu : elle vaut jusqu’au moment où le sujet, en redevenant actif, renie par sa conduite ce qu’il avait établi dans l’observation. À ce moment, l’observation se révèle une attitude, à côté d’une autre. Elle a pu apparaître comme la vérité pure, détachée de toute attitude, mais, là où elle atteint sa limite, elle se révèle être un point de vue : celui de l’observateur, qui pendant qu’il observe, a pu croire qu’il se passait de tout point de vue et qu’il touchait à l’absolu. En retombant dans l’attitude active, il se rendra compte que l’observateur a échappé à la conscience originaire plutôt qu’il ne l’a dépassée. Et l’observation, qui a pu paraître plus riche que la conscience originaire, lui semblera plus éloignée et abstraite. Le savoir du linguiste ne saurait remplacer l’activité du sujet parlant.
Une deuxième extension de la conscience originaire se produit par l’attitude prise par l’observateur vis-à-vis du temps. Ici la différence avec l’attitude active est très nette : celle-ci dispose dans le présent de l’avenir, tandis que l’observateur, étant dispensé de la tension vers le non-réalisé, peut prendre pleinement possession de tout ce qui a été réalisé. Libéré du souci de la réalisation, il laisse planer son regard sur l’ensemble de faits que la tradition et les documents ont conservés. La première extension en était une dans l’espace : c’est par le dehors que la conscience originaire apprend qu’il y a d’autres possibilités d’expression que la sienne et qu’elle comprend, sans le partager, le point de vue du libre observateur. C’est encore par le dehors, mais de plus près, que la conscience originaire apprend que son répertoire de mots est dû à un passé qui l’a formé et qui, à son tour, a été formé par un passé plus lointain, dans une continuité de changements. Une vision qui est tellement familiarisée avec les successions et les changements s’étendra facilement du passé au moment présent pour envisager celui-ci comme un chaînon dans la succession, pas encore fixé, il est vrai, mais en train de la devenir : cette vision traitera le présent comme destiné à être bientôt une réalité passée. L’attitude de l’observateur attend que le présent soit devenu du passé pour qu’il puisse le fixer. Mais cette manière de voir le présent provenir du passé et de le déterminer après son passage laisse entièrement en dehors la réalité originaire. Elle l’enveloppe dans l’indifférence d’un moment de la succession de façon à la rendre invisible, de la même manière que, pour la conscience originaire qui vit dans le présent, le passé reste invisible. D’où nouvel antagonisme entre le savoir et la conscience linguistique, exclusion mutuelle des deux sphères. Plaçons-nous dans le temps de l’activité parlante : le sujet dispose de l’instrument du langage. À cette disposition une acquisition doit avoir précédé. Réduire l’exercice de la disposition à l’acquisition, est l’affaire de l’observateur ; utiliser ce qui a été acquis sans rappel conscient de l’acquisition, c’est ce qui caractérise l’exercice de la parole.
Pour le dynamisme de l’activité parlante le langage, avec ses multiples éléments et leurs combinaisons, est donné de façon simultanée et qui échappe à la ligne du temps. Le sujet parlant puise dans un répertoire de moyens linguistiques, qui, entre eux, ne portent aucune marque chronologique. La conscience, inutile pour l’acte, de l’ancienneté de leur acquisition, diminuerait l’unité de l’acte de la parole. Le sujet parlant dispose du langage comme dans une dimension qui a été soustraite au temps et où toute trace d’acquisition antérieure ou postérieure a été effacée. La simultanéité de la disposition a ceci de négatif qu’elle abolit la différence des occasions et des moments où l’acquisition des éléments a eu lieu. Le dynamisme de l’activité de la parole unifie et spatialise ce qui a été multiple et successif dans le temps. C’est cet oubli systématique du passé qui fournit à l’observation son champ de recherches positives. C’est elle qui fixe, le plus ponctuellement possible, les moments et les occasions et de l’apparition des phénomènes dans l’histoire d’une langue et de leur acquisition par les sujets parlants. La conscience originaire ne sait rien de l’histoire des expressions dont elle dispose : pourtant elle puise sa substance dans le passé. Elle exclut, en vue des actes à accomplir, la vision de relativité qu’offre la recherche historique.
Une troisième extension par le savoir concerne l’atomisation des phénomènes. Nous venons de relever l’oubli comme attitude positive de la conscience originaire, et qui est une exigence de l’unité de son activité. Il faut ajouter la simplicité de cette conscience, qui est de nature à laisser des indistinctions là où l’observation trouve lieu à distinguer. La conscience naturelle remarque bien que les individus ne parlent pas de la même façon, mais cela ne l’empêche pas de les envisager comme parlant la même langue. L’observateur qui se place au point de vue « objectif » ne reconnaît pas l’unité de langue dans la diversité de la parole des sujets parlants ; tout au plus compte-t-il l’établir par voie inductive et toujours comme une unité relative qui consiste plutôt en une ressemblance ou convergence entre les langages produits par les sujets individuellement. L’unité relative à laquelle l’observation arrive par conclusion n’est d’ailleurs que semblable à celle qui préside à la conscience originaire de ceux qui s’entretiennent. Cette dernière, en effet, est inséparable de l’activité du sujet parlant, et c’est cette activité qui ne rentre pas dans la conscience de l’observateur. L’atomisation par l’observation, la découverte toujours plus grande de différences dans les données linguistiques, qui échappent à la conscience originaire démontre la tension polaire qu’il y a entre la réalité immédiate et son objectivation. Tout en ayant pour point de départ celle-là, la science s’en éloigne totalement. On dirait qu’en voulant saisir l’immédiat, elle le tue.
L’écart, qui s’ouvre, par la coordination et par le point de vue de la succession entre la conscience originaire et la conscience scientifique, reste encore limité tant que l’objectivation est basée sur une idée des faits linguistiques qui est empruntée à l’expérience subjective du savant. En ce cas, celui-ci est amené à ne plus partager les conceptions originaires sur les faits linguistiques, tout en conservant cependant en commun avec le sujetparlant la base d’activité linguistique dont le savant reconnaît avoir la même expérience que chaque sujet parlant. C’est à l’intérieur de cette base commune, d’après laquelle le linguiste autant que le sujet parlant sait ce que c’est que parler, comprendre, s’exprimer, que le savoir et la conscience originaire s’écartent l’un de l’autre. C’est un éloignement qui laisse subsister une unité de conscience entre le savant et le sujet parlant. C’est ainsi que la science linguistique vient éclairer la conscience originaire en lui proposant la multiplicité des variations, en intégrant dans l’absolutisme de l’activité une notion de relativité qui pourtant n’abolit ni l’activité linguistique ni le savoir qui lui est inhérent et qui est une façon dont elle s’entend elle-même. Ici l’observation laisse intactes des présuppositions grâce auxquelles un lien, peut-être inconscient, entre le savoir et la conscience originaire est maintenu. Ce n’est qu’en coupant ce lien que l’observation laissera tomber les dernières données qu’elle devait à l’expérience subjective, et qu’elle se dirigera vers un objectivisme exclusif vis-à-vis de n’importe quelle donnée de l’expérience subjective.
L’objectivisme radical se refuse à admettre que nous devions la moindre connaissance linguistique à l’expérience subjective. C’est l’esprit d’observation poussé à l’extrême. Il ne dit pas que nos vues sont limitées, notre savoir subjectif tant que nous nous en tenons aux données originaires : il dicte que tout ce que nous pourrons savoir sur la langue, nous le saurons par l’observation extérieure. Cela implique, que des termes comme signification, exprimer, comprendre ne peuvent être employés dans la science du langage dans le même sens que dans la vie – ou du moins dans un sens pareillement basé sur l’expérience intérieure. Le behaviorisme et le physicalisme poussent à l’extrême conséquence cet objectivisme exclusif. Pour ces théories, c’est à l’observation de fixer ce qui subjectivement s’appelle signification. La direction dans laquelle les présuppositions subjectives seront interprétées est tracée par la limitation que s’impose une observation extérieure. La signification devra être connue par la succession des actes linguistiques et autres, ou plutôt comme cette succession même : elle consistera dans la régularité observée de cette succession. L’introspection n’y sera pour rien.
Il est évident que l’observateur behavioriste essaie de couper tous les liens qui peuvent unir le sujet parlant au sujet scientifique. La conscience n’est même pas admise pour expliquer son propre savoir touchant les significations : l’observation extérieure fixera des significations qui sont des conduites, sans consulter la conscience originaire et contre elle. Les sujets linguistique et scientifique n’ayant plus de base commune, le premier est devenu l’objet du dernier. L’objectivisme de cette attitude permet de dépasser les faits linguistiques comme donnés en soi et d’en établir une origine hétérogène. En descendant dans l’échelle des actes on pourra appeler langage les réflexes et les réactions physiologiques. Ainsi on trouvera le langage déjà dans l’ordre des êtres vivants inférieurs. L’observation embrasse les données les plus diverses sous un aspect commun.
Le point de vue phénoménologique n’anéantit pas le savoir scientifique, il en démontre le caractère relatif. Il est opposé à cette théorie de la connaissance qui prétend que l’objet se constitue dans la construction scientifique ; le phénoménologue établit la détermination de tout savoir par la connaissance originaire. Cette connaissance est absolue en ce sens qu’elle est réalité et conscience en même temps. La science ne peut s’en tenir à cette sûreté immédiate qui est union d’acte et savoir. Elle en brise le cadre et s’en éloigne à des degrés variés et dans des dimensions différentes. La science se nourrit par l’observation, elle renie l’unité originaire qui ne laissait point de place à celle-ci. Le procédé d’objectivation est toujours dirigé en avant, il tend à laisser derrière lui son point de départ. Aussi la science ne connaît pas sa propre relativité ; une méthode en dehors d’elle est exigée pour la lui faire connaître. Cette méthode devra embrasser d’un seul regard la conscience originaire et l’objectivation en marche ; c’est ainsi que l’écart des deux pourra être connu et jugé. C’est à elle de démontrer quel est le sens de l’éloignement de la science par rapport à la conscience originaire, et en quoi celle-là reste redevable à celle-ci. Pareille démonstration éclaircira en quelle mesure toute objectivation reste nourrie de la substance réelle qui est antérieure à tout savoir ; elle mettra en lumière la nature de la transition au savoir, en ce que la science gagne et ce qui lui échappe. Elle rétablira ainsi l’équilibre entre les réalités primaires et l’objectivation qui se perd dans l’idée que la science se fait d’elle-même. Par cette méthode, on comprendra le savoir en fonction de la conscience originaire. Celle-ci se révèle contenir un en-soi qui est avant toute relativité ; c’est la science qui introduira celle-ci par la coordination de données semblables dans l’espace et dans le temps. Cette relativité est elle-même relative : elle vaut pour le point de vue du linguiste, sans écarter celui du sujet parlant.
C’est à une méthode philosophique qui surveille le mouvement et les attitudes de la science de juger de la valeur de la distance prise par certaines méthodes comme par exemple celle du behaviorisme. Elle montre qu’avec l’abandon des derniers fondements d’expérience subjective, l’objectivation a dépassé son point de cristallisation : l’écart de la conscience originaire que s’impose la science d’après sa nature est relatif par nature et limité dans ses possibilités. La science, dans toutes ses attitudes méthodiques, reste liée à la condition humaine. Elle peut s’écarter de cette base où objet et sujet font un, mais elle ne s’élève pas à un point de vue «absolu» : l’absolu est derrière elle, non pas devant. La nature humaine nous rend capables d’avoir conscience de nos activités par l’expérience intérieure, et d’étendre cette conscience par un savoir analogue mais reposant sur l’observation : elle ne nous permet pas de nous détacher des conditions mêmes de notre nature, et de nous connaître du point de vue de l’absolu. Si cela nous était possible, la connaissance de notre nature intérieure progresserait dans la mesure où augmenterait la distance que la science prend de la subjectivité concrète. Le cas du behaviorisme est là pour montrer que l’écart entre la conscience concrète et l’attitude méthodique ne saurait être augmenté toujours sans que la connaissance y perde. Ce qui revient à dire que la connaissance humaine a un seul pôle absolu : la conscience originaire, qui s’éclaircit par une intuition subjective et qui est connue d’une façon secondaire par les aspects relatifs que l’observation rend accessibles. L’absolu de notre connaissance sera dans l’affirmation de la conscience originaire ou il ne sera pas. L’absolu accessible à la connaissance humaine est celui de la subjectivité ; notre esprit de la façon dont il se connaît intérieurement et avant toute objectivation, se connaît de façon absolue. C’est cet absolu en deçà de la science objectivante qui fonde le savoir empirique et qui rend vain tout effort de connaître par l’objectivation ce qui appartient essentiellement à la subjectivité. Pour la linguistique cela signifie que l’éclaircissement méthodique de l’expérience vécue de la conscience préscientifique sera toujours le point de départ de la science du langage et qu’elle n’a rien à attendre du refus de l’accepter que proclame l’objectivisme avec la bonne intention de fonder une connaissance «absolument» objective. C’est sur une erreur concernant le sens que peut avoir le terme absolu que ce refus repose. Inspirée par l’exigence d’un absolu qui nous est impossible, cette erreur amène à négliger l’absolu possible, qui est dans la conscience subjective. Le linguiste qui se rend compte des faits du langage, par l’extension que prend son savoir, ne pourra qu’affirmer sa conscience de sujet parlant qu’il était avant la science et qu’il continue à être : c’est que, finalement, son savoir sera basé sur des données intuitives qui rendent possible l’objectivation, mais qui sont insaisissables pour celle-ci. L’écart entre la conscience originaire et la science n’est pas illimité : le linguiste est linguiste grâce au fait qu’il est un sujet parlant et non pas malgré ce fait. S’il est philosophe en même temps, sa réflexion se dirigera sur ce qui unit et ce qui sépare la conscience originaire et le savoir postérieur. Il ne se tiendra pas à l’image des faits linguistiques que crée la science, puisque pour lui cette image sera un objet et non pas une base. Sans s’identifier à l’objectivisme de la science, il en scrutera les origines et les motifs. Son point de repère sera toujours la réalité en-soi de la subjectivité originaire. Le fondateur de la phénoménologie a tracé un horizon immense de recherches à faire dans tous les domaines de la science. Il a fait comprendre la relativité de tout savoir par rapport à la conscience originaire qui contient les structures qui conditionnent son extension par l’expérience et par l’observation. Ce lien entre la science et le phénomène originaire existe partout. Dans le domaine des sciences humaines il se révèle comme une condition de la possibilité de ces sciences : il y a une linguistique par le fait que l’homme est un sujet parlant et qu’il se connaît en tant que tel, par l’aspect subjectif, par l’intuition qu’il a de sa propre réalité. Il y a une science du droit et de la morale par le fait que l’homme est le sujet du droit et de la morale, qu’il connaît absolument de son point de vue humain. C’est grâce à l’aspect originaire et subjectif de la connaissance que nous avons une théorie de la connaissance. Il en est de même de toutes les sciences humaines. Ce n’est pas le seul mérite de la phénoménologie que d’avoir réclamé pour la subjectivité les droits que l’objectivisme s’attribuait à tort. Mais c’est ce mérite qui rend la phénoménologie héritière d’une idée fondamentale de Descartes.
(1939) "Phénoménologie et linguistique", Revue internationale de philosophie 12, pp.354-365.