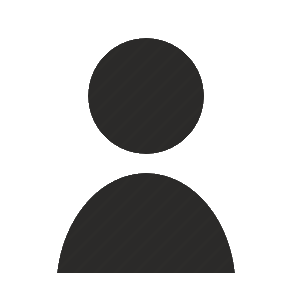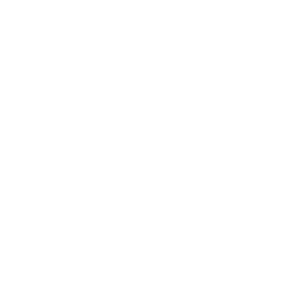This document is unfortunately not available for download at the moment.
La conscience linguistique préthéorique
Hendrik Pos
Translated by Patrick Flack
pp. 43-60
Le point de vue prévalant jusqu’ici qui tenait le langage pour quelque chose d’indépendant en soi, d’opposé à la conscience humaine et comme imposé à celle-ci par un ordre supérieur a laissé place récemment à une conception opposée. Aujourd’hui, il importe de combler autant que possible le clivage qui est introduit par l’étude analytique entre la conscience et le langage et de ramener dans le giron du vivant les éléments que l’analyse avait initialement isolés et mis en évidence. Le gain qu’offre cette nouvelle méthode est de prendre en compte la fonction médiatrice de la conscience, laquelle est en vérité porteuse de toutes les relations qu’un type de connaissance platement schématique a cru pouvoir établir directement entre les phénomènes linguistiques. On ne peut certes pas dire que la recherche se déroule toujours vraiment ainsi dans les faits. Tels qu’ils apparaissent sur le papier, en effet, les phénomènes linguistiques que réunis l’analyse comparative ne présentent en soi pas d’analogies avec la conscience. La majorité des grammairiens parle ainsi exclusivement de mots ou de formes : seul un pourcentage infime d’entre eux mentionne la conscience. Dans l’analyse technique, on ne prend que très rarement acte du fait qu’une personne vivante se cache en tant qu’auteur derrière chaque mot écrit ou gravé. Il a ainsi été découvert relativement tardivement, bien qu’il s’agisse d’un fait immédiatement évident, que tout manuscrit provient d’un copiste et tout original d’un producteur, autrement dit d’une personne dont il faut tenir compte, quand bien même une œuvre linguistique et sa source puisse au premier abord paraître très éloignées l’une de l’autre. – Mais le « gain » offert par la méthode susmentionnée apporte-t-il quelque chose de plus que le gain d’un nouveau point de vue ? Peut-il aussi nous révéler de nouveaux contenus ? Cela n’est pas évident d’emblée. Il est troublant, en effet, que bien des grandes avancées théoriques, par exemple l’établissement de règles phonétiques complètes ou la découverte de vastes correspondances entre des matériaux linguistiques en apparence très éloignés l’un de l’autre, ont été réalisées à une époque où l’on ne se souciait encore aucunement de la situation immédiatement donnée et analysable du vécu linguistique. Il est certes vrai qu’au cours des siècles s’est fait jour un retour vers l’expérience réelle qui a expurgé de façon critique et ramené à des conditions de possibilités déterminées les hypothèses de transformations complètement folles et arbitraires qui avaient jusque là permis de relier tout avec tout. Ce retour vers l’expérience est toutefois tombé dans l’excès inverse lorsque, en remplacement des principes arbitraires et jamais réalisés dans le langage qui semblaient justifier la vie mal connue et mal thématisée de ce dernier, a été érigé en principe méthodologique l’idée d’une nécessité d’airain tirée des sciences naturelles. Des étymologies qui nous sautent sans cesse et intuitivement aux yeux ont ainsi été écartées à cause de leur manque d’adéquation à une loi phonétique. Le fait que l’évidence d’une correspondance entre son et signification ait précédé l’établissement de toute loi particulière a ainsi également été négligé. En vérité, l’attitude « naturelle » occupe une position intermédiaire entre la loi et ce qui est nouveau ou inattendu, et ce sont donc ces deux pôles, celui de la loi et celui de l’exception (ou de la nouveauté), que l’approfondissement et le développement de l’expérience peuvent transformer en principe méthodologique. La recherche de lois assemble et réunit ce qui est tout à fait discret dans l’immense flux du vivant immédiat. La découverte de la « véritable » structure d’un phénomène n’en demeure pas moins une expérience absolument singulière. Lorsqu’on ausculte soit un mot que l’on a employé spontanément d’innombrables fois et que l’on perçoit comme une unité, soit une expression figée dont le sens s’est fixé avec l’usage, ceux-ci se décomposent en une sorte d’assemblage constitué d’éléments plus limpides de même type.* À l’inverse, un mot composé peut se transformer progressivement en un mot simple et une expression syntaxique fixe peut ne plus se distinguer d’un mot composé. Dans notre propre langue, on se rend compte de ces faits après-coup, réflexivement. Dans une langue étrangère on les constate d’emblée, immédiatement. – La conscience linguistique originaire, qui se manifeste avant tout de façon active et non-théorique – bien qu’elle recèle un potentiel théorique –, se déploie donc dans deux directions opposées, celle d’une analyse reconstructive de ce qui se donne comme un tout concret dans la conscience linguistique immédiate et celle d’une attitude psychique qui cherche à saisir comme une totalité un matériau qui lui est initialement étranger et qu’elle ne peut mener à une certaine unité qu’en l’épelant.
Arrêtons-nous un instant sur la question de cette conscience linguistique que nous avons initialement caractérisée comme étant originaire. Cette désignation est-elle correcte ? La relation la plus fondamentale au langage est-elle bien celle d’une conscience ? Beaucoup dépend de la réponse à ces questions car toutes les « possibilités » ultérieures y sont investies. Comment le langage se manifeste-t-il initialement dans notre vie ? Quel est notre rapport primitif à lui ? Nous apparaît-il d’abord « autrement » qu’il n’est vraiment ? Reste-t-il inchangé par ce que nous faisons avec lui ou, au contraire, sa rencontre avec nous le transforme-t-elle justement en quelque chose qu’il n’était pas auparavant ? Nous voyons bien que le langage est quelque chose auquel nous avons « affaire ». Mais les éléments qui nous permettent de saisir sa forme se déploient parallèlement dans des dimensions si diverses que même le plus attentif des observateurs ne peut s’en faire une image d’ensemble que de manière extrêmement schématique. Notre objet est simultanément visible dans l’écriture, audible dans le discours et la conversation, palpable sur la pierre ou le papier, sans être pour autant jamais donné « entièrement » ni ici, ni là. Pas même la désignation d’être « réel », qu’il partage avec tout ce qui existe, ne le recouvre entièrement. En sus des nombreuses choses qui sont réelles et réalisées dans le langage, il existe en effet encore beaucoup de choses possibles qui ne se réalisent jamais, en témoigne par exemple le fait que l’on puisse réagir à certaines expressions – à un niveau linguistique qui n’est plus réceptif mais normatif – en disant « on (ne) peut dire cela ». Vossler examine ce fait dans son article « Les individus et le langage », (Philosophie du langage, p. 19) : « l’histoire du langage… doit partir de la prémisse que tout ce qui a été accompli dans une langue à une époque donnée était aussi possible… et de la sorte, tout ce qui n’a pas été accompli et n’a pas été utilisé peut sembler impossible. Mais on ne va tout de même pas croire que tout ce qui est possible dans l’histoire d’une langue a été réalisé. » L’impossibilité d’une détermination hic et nunc du langage est ainsi démontrée. Certes, tout mot prononcé, toute phrase ou toute conversation au sens large est aussi quelque chose, ici et maintenant, mais l’isolation que mêmes ces déterminations là imposent au langage a aussi comme conséquence d’exclure de l’analyse des strates structurelles plus profondes. Il est déjà artificiel de retirer une phrase unique de son contexte illimité et il l’est d’autant plus d’isoler un mot ou une racine. On ne peut toutefois pas atteindre le contenu du langage sans de telles opérations. L’hypothèse dictant que tout ce qui est individuel n’est compréhensible ou même visible que dans un système constitue en effet certainement un principe de recherche correct. Cette idée ne remplace toutefois en aucune façon la qualité la plus propre de l’individuel, laquelle est donnée avant tout avec celui-ci et non par la force du système. Si l’individuel se dissolvait vraiment dans les relations d’un système, il ne serait plus différenciable en tant que tel. On ne peut faire l’expérience de l’individuel que si tout ce qui est général et relatif est que quelque chose en lui mais n’est pas l’individuel « lui-même ».
On peut déjà constater les deux moments de l’individuel et du relatif dans la conscience linguistique « originaire ». Certes, le langage se manifeste en tant que tel, mot après mot, dans l’environnement indifférencié de l’enfant. Mais, ici non plus, il ne se donne pas comme une série successive clairement identifiable, mais plutôt comme un entrelacement de contenus et d’opinions signifiants, de sorte que toute la complexité de la vie consciente pré-linguistique se projette déjà sur les problèmes linguistiques. Cette projection ne doit cependant pas nous servir d’asylum ignorantiae où nous nous réfugierons en réaction contre les platitudes de l’objectivation qu’amène la loi. Toute loi que nous découvrons, en effet, doit avoir plus qu’un pur aspect de régularité. La répétition d’un phénomène linguistique – laquelle, à y regarder de plus près, ne représente dans un premier temps qu’une façon subjective particulière d’ordonner un certain matériau – possède plus qu’une simple valeur de catégorisation, car toute série extérieure est liée de manière immédiate avec une série intérieure psychique qui vise une seule et même chose.1 À vrai dire, la particularité du langage est justement qu’il n’admet pas de séparation entre ces séries malgré le fait qu’une différenciation soit réellement justifiée. En fait, la différenciation qui unit mot et chose en définissant l’un comme étant le signe de l’autre est elle-même un produit de la réflexion. Il existe ainsi une relation encore plus intime et antérieure à la réflexion, dans laquelle le mot et la chose ne sont encore pas du tout opposés : le mot constitue ici plutôt un aspect de la chose, voire l’aspect même par lequel la chose se présente puisque présentation et représentation sont alors encore étroitement liées. Cet intime entrelacement entre mot et chose, dont on trouve également un certain équivalent chez les animaux, est un fait linguistique fondamental. La conscience linguistique trouve là son commencement le plus concret et naturel. Il n’y a pas d’autre identité entre les mots et les expressions que celle de l’indifférenciation. À ce niveau, même les synonymes, pour autant qu’ils existent, ne « signifient » pas « la même chose » : ils diffèrent déjà dans leur forme externe, et il n’y a ainsi pas de synonymes. Ce fait est aussi à l’origine du premier élargissement qui conduit à l’explosion de l’environnement originaire de l’individu : comme sa conscience linguistique concrète ne connaît encore ni « étrangers », ni « autres » langues, l’élargissement de ses limites originaires intervient en effet d’abord ici. Cela ne veut pas dire que l’horizon initial de la conscience linguistique d’un individu possède une limite claire, marquée par la soi-disant langue maternelle. Car même au sein de cette dernière, le champ de chaque individu est différent. Tout homme commence certes « ponctuellement » par apprendre des mots et des expressions, mais une fois parvenu au point où il peut communiquer avec un interlocuteur sans hésitation et sans se faire remarquer, il entre dans une relation inégale avec les autres. Au sein de l’horizon total de la communauté linguistique, en effet, se détachent comme des îlots d’intérêts ou des groupes sociaux.* Certaines personnes restent toute leur vie sur leur île, sans prendre conscience du caractère insulaire de leur existence sociolinguistique, alors que d’autres parcourent sans relâche leur pays entier, poussées soit par leur profession, soit par la force d’une grande ou altruiste soif de connaissance. Il faut ainsi opposer un concept de série graduelle à la conception habituelle qui considère chaque représentant quelconque d’un groupe linguistique comme prototypique. Dans la mesure où une telle série n’implique pas seulement une simple juxtaposition de types interchangeables, elle se fonde sur l’idée d’un représentant idéal qui est certes indispensable en tant que support conceptuel mais qui n’existe pas empiriquement puisqu’il est impossible pour un seul individu d’atteindre une connaissance qui serait uniformément développée dans tous les domaines du langage. L’hermétisme et le recentrement plus ou moins forts qui conditionnent les consciences linguistiques individuelles sont donc sources de miroitements phénoménologiques: l’inévitable frottement entre les divers groupes n’exerce pas seulement une influence sur le matériau linguistique objectif, mais suscite également dans la conscience de ceux qui se rencontrent toute sorte d’impressions qui ne correspondent pas à celles d’un observateur théorique et extérieur à tous les partis, mais qui sont plutôt influencées par de puissants jugements ou expériences subjectives. Pour l’habitant du village reculé, un compatriote de la ville est déjà un « étranger » dont il observe l’apparence et les gestes avec des sentiments partagés. Il serait très intéressant de savoir quelles circonstances et peut-être quelle durée de temps sont capables de rendre vraiment solidaire deux types qui sont à l’origine étrangers l’un à l’autre. À l’armée, où se rencontrent par exemple des gens qui en temps de paix se côtoient avec indifférence, l’ennemi se profile soudain très clairement comme un étranger commun. En dehors de tels événements de réconciliation nationale, les membres d’une tribu ou d’une langue peuvent toutefois être très hostiles l’un envers l’autre. Cet état de fait se reflète linguistiquement dans des incompréhensions volontaires ou des imitations moqueuses dont le caractère exagéré ou déformé permet de décharger soit une vraie antipathie soit du dédain. Si chargée émotionnellement et personnellement qu’elle puisse bien paraître, la conscience s’oriente en fait déjà d’une certaine manière vers la théorie. Il en allait de même pour le fier grec de l’Antiquité qui, bien qu’il ne voulait voir dans l’étranger qu’un « balbutieur », considérait celui-ci, et ce malgré la forte coloration subjective de l’attribut, dans une perspective linguistique théorique, à savoir comme un homme qui parle « autrement » que lui-même. Une description satisfaisante de ce sentiment n’a pas été fournie.
La science est une tentative de dépasser les limites de la conscience linguistique originaire, personnelle, pratique et vouée à la vie. L’existence même de la linguistique prouve que cette tentative est plus ou moins possible. Une analyse plus approfondie de la linguistique révèle toutefois aussi, d’une part, qu’elle contient plus d’éléments psychologiques et relatifs et, d’autre part, moins d’éléments désintéressés que ce que la représentation objective des faits « certains » ne le laissait initialement présupposer. Parce que, en un sens vital, tout chercheur se trouve quelque part « chez lui » et est donc soumis à la condition incontournable d’un fondement concret, sa position est partiale et son approche de ce qui lui est initialement « étranger » doit partir du sol de ce qui lui est connu et propre. Ce fait est une condition naturelle, bien que les limites entre le propre et l’étranger soient en fait relativement fluides. Si une connaissance absolue de la langue « propre » n’est nulle part donnée, on est alors en principe toujours plus ou moins étranger. Quelque chose de mystérieux, d’irréductible se cache au premier abord dans l’interdépendance de l’individu, du peuple et de la langue, mais cette impression semble se désagréger en rapports relatifs lorsqu’on y regarde d’un peu plus près. Avec cette relativisation, on ne différencie plus entre l’authentique et l’inauthentique, mais plutôt entre ce qui est plus ou moins usité ; on ne distingue plus l’ancien du nouveau, mais plutôt ce qui n’est plus d’actualité et ce qui est actuel précisément maintenant. Il est ainsi possible d’envisager un positivisme linguistique qui réduirait à quelque chose d’objectivement exact tous les éléments qui sont les moins facilement saisissables, autrement dit la sphère entière des impressions et des sentiments vagues et généraux qui surgit dans chaque individu lors de l’acquisition d’un « matériau » isolé. Une telle objectivisation exacte n’englobe cependant que les éléments phonétiques et les éléments purement réguliers. Elle ne pourra jamais se présenter avec la prétention d’englober tout ce qui existe si elle néglige les fondations humaines du langage, c’est-à-dire les fondations partielles sur lesquelles chaque chercheur se base pour accomplir son travail d’objectivation et grâce auxquelles cette objectivation représente autre chose qu’un système physique qui existerait en dehors de lui.
Les miroitements inter-individuels du langage dans les rapports quotidiens, c’est-à-dire lorsque l’attention n’est pas exclusivement dirigée sur le contenu de ce qui est échangé, sont très divers. En parlant, nous participons tous avec une certaine distance à notre environnement et, dans un sens spécial, à nous-mêmes. Lorsqu’il nous est adressé, le flux linguistique se dirige vers nous de façon directe, pour ainsi dire de front. En qualité d’observateur silencieux d’une conversation, nous percevons le langage comme de biais, il virevolte entre les interlocuteurs tel une volée d’oiseaux (cf. Homère et son discours « ailé »). En tant que témoins a posteriori de nos propres mots, nous saisissons ceux-ci comme de dos. La spécificité de la condition humaine limite ces trois possibilités : chaque individu ne peut traiter en un certain temps qu’une certaine quantité des choses qui lui sont adressées. Puisque même l’écoute attentive d’une œuvre orchestrale compliquée exige déjà un certain effort bien qu’elle ne nous soit pas personnellement « adressée », il est évident que d’écouter plus d’une personne à la fois nous « sollicite » encore plus. Un orateur politique auquel s’adressent plusieurs voix excitées venant du public se trouve dans la même embarrassante situation qu’un malheureux enseignant faisant face, dans sa classe, à plusieurs voix d’élèves s’interpellant entre eux. Toute autre, et pourtant fort similaire en un certain sens, est la situation que chaque citadin traverse quotidiennement. Tant de mots et de conversations frémissent autour de nous dans la rue et dans les transports en commun, mais si peu d’entre eux nous sont adressés ! Il est impossible de tous les saisir d’une façon informée* : qu’on les désigne comme un tout ou une masse, nous n’exprimons par là que le caractère non-synthétisable du contenu sonore total des énoncés humains au cours d’un certain laps de temps. Même un salon rempli d’invités représente une situation difficilement maîtrisable pour un esprit individuel. Une hôte nous apparait ainsi d’autant plus digne de louanges quand elle réussit à la fois à organiser sa société en groupes harmonieux et à maintenir une certaine unité en s’efforçant, en dispensant un mot amical à chacun, de n’isoler personne complètement. Toujours est-il qu’un tel ensemble constitue une espèce de tout hétérogène, ce dont se rend mieux compte un observateur externe que les participants occupés à leurs conversations. Le contraste est une forme spéciale de l’unité de l’hétérogène. Il est en effet tout à fait possible que tout le monde s’entretienne « de la même chose » en même temps en un même lieu. Mais il n’y aurait alors nulle part de place dans la communauté humaine pour la perspective d’une « différence dans l’unité ».* Bien qu’un certain sens général se dégage de n’importe quelle réunion, même fortuite, celui-ci ne nous donne par lui-même aucune information sur les éléments qui lui sont subsumés et qu’il indique plutôt qu’il ne les saisit. Tant que les personnes individuelles sont considérées indifféremment comme les porteurs et les exécutants de ce sens général, la propriété commune au sens qui les réunit déteint également sur une individualisation limitée des personnes ne dépassant pas le stade de la différenciation de leurs noms et du facteur distinctif que ceux-ci recèlent. Que ce soit en tant que témoin, auditeur, participant, lecteur, voyageur, piéton, passager, orateur, communicant ou candidat, des personnes quelconques peuvent être réunies en un tout dont le sens général ne permet pas de déduire la réalité de leur individualité. Ne perdons toutefois pas de l’œil le sens de notre exposé, son fil linguistique. En somme, notre analyse nous a présenté une toute autre forme, encore très directe, de la conscience linguistique, celle d’une communauté linguistique qui se forme en relation au sens ou à l’espace. Victor Hugo propose dans « Les misérables » (Nelson II, 26) une image fort vivace de ce type de communauté qu’il est possible de se représenter mais dont le sens est encore très lâche: « Pendant toute cette conversation,… Cosette, comme si un instinct l’eût avertie qu’on parlait d’elle… Cependant les buveurs,… répétaient leur refrain immonde… Cosette… chantait à voix basse : Ma mère est morte !... Les ivrognes chantaient toujours leur chanson et l’enfant, sous la table, chantait la sienne ».
La possibilité de la « conscience linguistique » à laquelle nous avons abouti s’intéresse certes encore au mot de façon primaire, mais non plus en tant qu’objet : elle est tournée maintenant vers la parole comme l’acte d’une personne. Cette description de la conscience linguistique ne vaut toutefois pas encore pour l’effet de contraste susmentionné. Dans ce cas-là, nous avions affaire à la diversité émotionnelle concrète de tout ce qui peut être dit dans un espace ou pendant un certain laps de temps. On retrouve certes en arrière-plan la figure d’un locuteur quelconque. Mais cette figure ne vient occuper l’avant-scène que lorsque un locuteur exprime quelque chose de frappant par son intensité, sa vitesse, son aisance. Dans tous ces cas, l’attention de l’observateur se déplace alors au-delà du contenu. La cause pratique de ce déplacement réside entièrement dans l’objet (le locuteur) puisque c’est la masse frappante des éléments secondaires « inhérents » à ce qu’il dit qui occasionne un trouble ou une interruption de la compréhension, ou du moins une diversion. Il est vrai aussi que, en pratique, quelque chose qui possède pourtant un intérêt théorique pur dans toutes ces formes et degrés ne se constitue en tant qu’objet que dans des cas spéciaux ou frappants. Cela est lié au fait qu’on ne donne d’abord de nom qu’à ce que l’on trouve frappant, dérangeant ou irritant dans une certaine manière de parler – et c’est ce nom qui sert ensuite pour désigner le concept d’une série de mêmes phénomènes de degrés divers, par exemple « chaud », « dur », etc. Si ce n’est donc pas à cause de sa qualité remarquable, mais parce qu’il dérange que nous constituons une chose quelconque en objet théorique, n’importe quoi peut être remarquable pour la théorie et ce qui est nommé en premier ne constitue alors qu’un cas spécial d’une série plus complète. En ce qui concerne la conscience linguistique élargie, tout un chacun possède des caractéristiques particulières et le concept du remarquable reçoit ainsi une signification plus pure, moins sensible. Au premier stade, l’impulsion extérieure ne fait qu’éveiller la pensée. Au second stade, la pensée n’est donc pas moins stable si elle a été mise en mouvement par un cas particulier que si elle a découvert un type universel général par ses propres lois. Cette généralisation idéale de l’orientation théorique de la pensée implique néanmoins au niveau empirique une unification sociologique du champ des individus. Seule une minorité d’entre eux s’élèvent en effet au-dessus de la vie pratique, c’est-à-dire théoriquement contingente, et atteignent la pure théorie pour laquelle les événements contingents ne représentent que des occasions. Ce saut est à vrai dire quelque chose de fantastique, bien qu’indubitablement réel. On peut supposer qu’au « début » la situation linguistique sociale n’impliquait qu’un locuteur et un auditeur aux intérêts purement concrets. Cette supposition s’appuie négativement sur le constat empirique que les personnes d’une éducation linguistique limitée sont moins promptes que les personnes mieux éduquées à reconnaître un étranger à sa langue. Si le champ linguistique d’une personne plus modeste est plus uniforme et plus complet, ses limites se dessinent d’autant plus clairement. Lorsqu’une telle personne reconnaît quelqu’un comme étant un habitant d’une autre région linguistique, ce dernier lui apparaît immédiatement comme un autre ou un étranger qui lui inspire respect ou antipathie et qu’elle accueille soit avec respect et bonne volonté, soit plutôt avec suspicion et un élan de haine. Par contraste, l’oreille de l’homme éduqué est plus réceptive et son esprit – pour autant qu’il ne soit pas l’opposé arrogant de la méfiance du prolétaire – est plus souple et libre, plus disposé à accepter la multiplicité des différences linguistiques qu’à se livrer à une moquerie incompréhensive. Certains relents du stade initial de l’homme pris dans l’horizon spatial de son environnement concret et réagissant de façon viscérale à l’étranger persistent aussi chez l’homme éduqué. Dans la mesure où on ne s’interdit pas d’emblée de considérer la moquerie et la pruderie (émotions dont même les chercheurs les plus objectifs ne peuvent supprimer les élans lorsqu’ils ont affaire à certaines expressions) comme des catégories constitutives de la connaissance, celles-ci apparaissent comme des formes primitives et socialement conditionnées de la compréhension. Nous parvenons ainsi à une limitation de la prétendue réalité de la situation linguistique sociale initiale, à savoir qu’on n’y trouve pas à la fois tous les individus et toutes leurs sphères de réalité relatives, mais seulement ceux qui partagent un sol commun. La possibilité de la conversation, ce berceau initial de la vie du langage, ne repose pas seulement sur le langage mais aussi sur les choses concrètes. De même, la communauté d’expression ne suffit pas à la compréhension mutuelle. Il y a donc de la place dans le stade initial pour des inhibitions de la conversation et des diversions de l’attention. Des personnes qui ne se sont jamais vues interagissent autrement les unes avec les autres sur un plan linguistique que des personnes qui se connaissent déjà. On peut observer cela dans la vie quotidienne. La situation initiale se trouve ainsi relativisée. Car si deux personnes se rencontrent dans une situation concrète commune, il s’agit alors pour elles de se comprendre mutuellement, et dans le cas contraire, leur sentiment d’étrangeté mutuelle résulte alors de couches plus profondes que celles du langage.
L’enfant ne perçoit que les choses et les mots alors que l’adulte possède de surcroît une conscience de sa propre parole et de celle de l’autre : pour lui, il y a un locuteur derrière la parole. Cela nous ramène à la profusion des miroitements phénoménologiques. Notre représentation des mots d’une personne se joint en effet à celle de son expression corporelle et du contexte qu’elle évoque. De tout cela, il ne reste rien dans l’étude objective du mot. Les lignes de nos intérêts pragmatico-linguistiques d’un côté et purement linguistiques de l’autre sont perpendiculaires. La conception simmelienne du « changement d’axe », c’est-à-dire le revirement général de l’esprit pratique vers la théorie2, paraît très bien s’appliquer ici. Il faudrait même approfondir cette image en ce sens que lors d’un second mouvement similaire, l’orientation de la conscience originaire ne peut être reconquise qu’avec le signe négatif de la reconstruction. Dans une coupe verticale sur la ligne du progrès, chaque mot de la phrase apparaît comme une projection indépendante sur l’axe de la parole. La distance entre la conscience linguistique originaire et réflexive est ici la plus grande, car on a progressé vers la plus grande isolation statique possible. Un tel procédé est nécessaire pour la théorie, il se profile même dans un premier temps comme la seule orientation possible pour la conscience linguistique théorique. Dans cette perspective, les étapes individuelles du processus linguistique deviennent visibles, mais pas le processus lui-même ou encore la succession définie des étapes. La conversation se transforme en un assemblage de projections tirées soit du « dictionnaire », soit de la totalité conçue statiquement des formes possibles. On exprime aussi ce même fait lorsque l’on dit que les règles d’une langue doivent être appliquées correctement dans l’usage linguistique. Cette projection donne lieu toutefois à un reste vivant, et il s’agit là de la dynamique de la relation elle-même. La théorie doit descendre des hauteurs de l’observation verticale et isolante jusque dans le langage réel (c’est-à-dire usité), et la conscience linguistique, sortant de sa concentration primitive sur la chose et comme se divisant elle-même, accompagne alors réflexivement son propre mouvement. Cela rend possible la détermination du sens d’un mot en dehors d’un contexte réel, alors pourtant que le mot n’est donné « originairement » que dans un contexte. La réflexion peut aussi découvrir des constructions, des manières de parler, des étymologies, de la même manière que les nuances intuitives d’expression dont la signification est objectivement similaire paraissent évidentes à la conscience, mais sans pour autant que cette différence se laisse formuler d’aucune façon.
La réflexion sur la langue propre nous prépare à pénétrer le champ linguistique étranger. Cela aussi est une des capacités de la conscience linguistique. La réflexion sur le propre ne peut toutefois être sollicitée ici que dans la mesure où elle est déjà au fait des nouvelles phrases ou expressions que nous employons pratiquement dans notre propre langue.* La première rencontre avec une langue « étrangère » commence indubitablement avec le mot. L’étrangeté de l’autre langue est ici encore peu marquée : dans ce cas, un symbole linguistique est juste remplacé par un autre. Il est particulièrement facile de saisir sa signification lorsque cet autre symbole ressemble d’une manière ou d’une autre au symbole de la langue maternelle. Au premier abord, un symbole extérieurement similaire peut éventuellement paraître identique. Ceci est une illusion qu’encourage particulièrement l’écriture et qui conduit au constat linguistique théorique suivant : a signifie chez les A la même chose que b pour nous, ou : les A nomment a par b. Le degré d’étrangeté est dans ce cas encore réduit. Le mot de la sphère propre, en effet, sert ici pour la mémoire de substrat conscient à partir duquel un mot étranger est formé ensuite. Dans des langues apparentées, il est ainsi possible de poser des séries de correspondances dont la relation fonctionnelle représente une loi de correspondance déduite par induction. La différence entre langue propre et étrangère se fait toutefois déjà sentir ici et la véritable étrangeté des mots qui semblent se correspondre relativement ou individuellement se dégage de façon toujours plus claire. Il y a bien sûr des gens qui ne prennent pas conscience de ce fait. En dessous d’un certain degré de clarté d’observation et de vigilance, on peut envisager de faire dériver les mots similaires de sa propre langue, selon une loi de correspondance tirée d’une induction limitée. La manière dont certains étrangers assimilent sans ménagement ou mauvaise conscience la langue apparentée de leurs voisins à la leur est un bon exemple de tels cas. Une certaine dose de clairvoyance introspective et d’expérience est nécessaire pour pouvoir concevoir sa propre existence, sa propre spiritualité et ses propres expressions linguistiques comme des cas concrets particuliers de possibilités aléatoires. La réflexion sur la langue propre peut y contribuer grandement. L’anomalie dans un mot, la formation ou la liaison d’un mot par rapport à un schéma logique simple est déjà visible dans la langue propre, et il arrive parfois que le schéma de la langue étrangère soit plus conséquent encore que celui de la langue propre. La réflexion constitue également une excellente préparation didactique à l’étrangeté de l’autre langue : du dehors, celle-ci ne semble qu’utiliser d’autres groupes de sons pour former ses mots, certes avec une autre intonation, articulation, etc. Mais les relations complexes autant externes que internes de ses sons possèdent en fait des structures tout à fait propres. Pour un observateur attentif, les formes expressives et l’esprit d’une langue étrangère constituent une totalité qui n’est définissable et percevable que de façon approximative. L’auto-critique dans l’usage de la langue étrangère doit augmenter dans la mesure où l’expérience apporte un matériau certes toujours plus conséquent, mais dont le véritable esprit semble toujours se situer à une couche plus profonde que celle que l’on vient d’atteindre. Une personne qualifiée se comporte en mystique relativement à l’acquisition d’une langue étrangère, la personne non qualifié en rationaliste.
Les stades de conscience linguistique possibles discutés jusqu’ici sont donc les suivants : 1° le champ de la capacité linguistique ne s’étend qu’à l’environnement immédiat ; 2° on rencontre un étranger ; 3° on réfléchit sur la langue propre ; 4° on s’approprie la langue étrangère comme un simple analogon de sa propre langue (rationalisme, outrage de l’esprit de la langue étrangère) ; 5° on découvre la particularité et la distance infinie de la langue étrangère. Comme l’observation de la langue étrangère se répercute toujours d’une certaine manière sur la sienne propre, on a donc aussi une perspective infinie sur sa propre langue, quoique d’une autre manière que sur la langue étrangère. Ce que nous réalisons linguistiquement est une partie du contenu de la langue propre, ce que nous réalisons dans une langue étrangère est toutefois hors-limite. Les modalités de la rencontre entre deux cercles linguistiques dans une conscience sont certes très diverses. L’étape de l’analogie rationnelle, par exemple, dure plus longtemps dans le cas de langues fortement apparentées. Ainsi certains Hollandais pense être capables de produire de l’Allemand par l’entremise de quelques modifications du système phonétique de leur langue. À l’inverse, beaucoup d’Allemands considèrent la langue hollandaise comme un dialecte du bas-allemand. Une telle interprétation est exclue même dans une expérience superficielle du français et de l’italien. Là où la linguistique dépasse le cercle connu d’elle depuis longtemps de l’indoeuropéen et du sémitique, elle se retrouve face à des possibilités insoupçonnées de construction ou de composition de mots. Cela ne concerne encore que l’état objectif de la langue. Malgré l’existence d’une « humanité » commune, les différences dans la dimension subjective ne sont cependant pas moindres, en particulier là où le point de vue objectivant ne fait rien ressortir de particulier. Certains groupes linguistiques sont plus silencieux que d’autres, les uns sont plus loquaces (les Athéniens), les autres plus discrets (les Spartiates). Dans le cours d’une conversation, l’un ne pourra s’empêcher de faire une remarque alors que l’autre s’en abstiendra, bien que rien ne l’empêche de la faire. La conversation avec des hôtes étrangers devrait révéler des différences intéressantes dans les différents pays. En considérant certaines possibilités générales, on revient au donné empirique à partir duquel on était parti. Le schéma logique des « possibilités de la conscience linguistique » débouche de façon méthodique sur un large champ de recherche. Rétrospectivement, nous voulons encore relever que le chemin à rebours que nous avons rapidement parcouru ici, de la conscience linguistique préthéorique au théorique, n’a pas été rectiligne et que la réalité elle-même nous a conduit parfois à emprunter des chemins de traverses. Mais cela prouve seulement qu’un schéma a priori se révèle toujours comme étant trop simple dès que l’expérience qui n’était initialement pensée que sur la base d’une idée générale nous montre son véritable visage. L’expérience, dans le langage également, est toujours au service de nos idées les plus générales car elle les attend. Mais elle est aussi une source qui offre leur élan vital aux idées. C’est avant tout de par cette double fonction que l’expérience de la linguistique, à l’instar de toute autre science, se fait véritablement philosophique.
(1925) "Vom vortheoretischen Sprachbewusstsein", Philosophischer Anzeiger 11, pp.43-56.