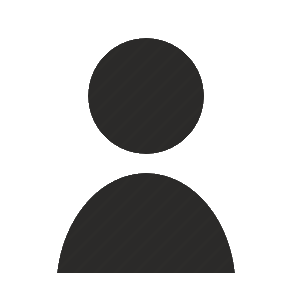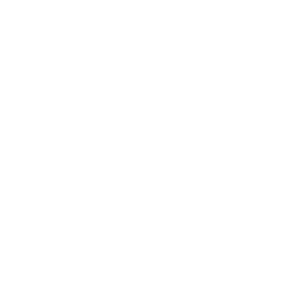This document is unfortunately not available for download at the moment.
Le langage et le vécu
Hendrik Pos
pp. 233-246
Le fait est incontestable : c’est principalement au langage que nous devons d’entrer dans le monde humain. On a constaté que les êtres humains, abandonnés dès l’enfance dans une région déserte, n’étaient pas dénués d’intelligence quand on les retrouva, mais que toute vie mentale supérieure leur faisait défaut. Instructif à cet égard est le cas de l’Américaine Helen Keller. Ayant perdu toute jeune, la vue et l’ouïe et, de ce fait, exclue des voies normales de contact avec le monde, elle reçut la révélation du langage de sa gouvernante qui épelait les mots en se servant de signes tactiles imprimés dans la main du sujet. Après des tentatives en apparence vaines, Helen Keller eût, comme elle le raconte dans le récit de sa vie, un éclair de compréhension le jour où elle saisit que les figures tactiles représentant le mot « water » signifiait l’objet que son autre main touchait, autrement dit, qu’il y avait une identité entre cette série de figures et un objet. Cette découverte était vertigineuse, car elle l’induisait à croire que ce lien mystérieux existait, non seulement entre le mot « water » et sa signification, mais dans une infinité d’autres cas : la découverte du lien qui unissait le mot et la chose impliquait celle du langage comme tel. L’œuvre d’Helen Keller est là pour démontrer de quelle activité littéraire a été capable une personne dont la jeunesse fut si tragiquement mutilée. Il est tout à fait normal que la valeur qu’a pour chacun de nous la possession de la langue nous amène à envisager le monde et les objets sous l’angle de l’expression et de l’expressivité. Le parler nous paraît alors comme une lumière qui éclaire les choses et dont la source est chez ceux qui parlent. Certaines étymologies semblent témoigner qu’anciennement un rapport a été senti entre montrer, faire apparaître et parler. (La racine φα en grec est à l’origine de φημί, de φαίνω et de φάος.)
Or si toute vie humaine et interhumaine a pour atmosphère le langage, sommes-nous justifiés à admettre avec l’idéalisme que c’est dans le langage qu’est la source même de l’intelligence et grâce à lui qu’il y a une communion humaine, une pensée et une entente ? Nous allons énumérer des faits, qui semblent s’opposer à l’identification du langage avec la pensée et avec l’apparition du monde à la conscience : nous les trouverons :
a. dans l’objet perçu
b. dans le vécu (états affectifs, états automatisés)
c. dans l’effort non-linguistique
d. dans la vie pré-linguistique de l’homme
e. dans le symbolisme de l’intelligence animale.
Commençons par la perception. Elle aboutit naturellement à l’énoncé. C’est une joie que de savoir dire les noms des choses. L’objet vu y est reconnu dans son essence. Par cet acte, il est libéré de son isolement muet et placé dans un cadre qui l’unit à d’autres objets non donnés à la perception, mais qui se subsument sous le même énoncé comme appartenant à la même essence. L’essence est donc une espèce de nouvel objet qui apparaît à travers l’objet perçu, non pas aux yeux corporels mais à ceux de l’esprit. Et puisque l’essence tend à remplacer l’objet perçu faisons le bilan de leurs vertus propres. L’objet particulier est donné aux sens, il appartient au monde réel. L’essence n’a pas de réalité, mais en revanche elle appartient au supra-temporel, elle n’est nulle part et pourtant elle est partout dans l’espace et dans le temps. Elle contient tout ce qui est propre à l’objet perçu. L’essence est apriorique par opposition à l’objet réel qui est son exemplification.
C’est par des raisonnements bien connus que depuis Platon l’essence l’a emporté sur l’objet perçu. L’attention de l’épistémologie s’est détournée de celui-ci en faveur de l’essence. Ceci n’aurait pas été possible sans l’appui du langage : c’est à l’occasion de l’emploi du mot que surgit l’idée de l’essence. Ceci arrive au moment où le mot abandonne sa fonction subordonnée d’orientation pour réclamer une fonction apriorique dans la connaissance des objets donnés. Nous entendons par fonction subordonnée que le mot aide à orienter la connaissance de l’objet perçu sans que son intervention détourne le regard de l’objet perçu. Il existe en effet une fonction du mot qui consiste à fixer davantage l’attention sur l’objet nommé. Mais cette fonction est labile : le mot au service de la perception devient très facilement le mot qui préside à la perception et la dirige puisqu’il fournit d’emblée une connaissance qui ne dépend plus de la perception. La priorité que prend ainsi le mot sur la perception est un détournement par rapport à la perception et à sa richesse. Cette richesse tient à ce que la perception a une plénitude qui non seulement n’est pas exprimable par un seul mot, mais qui ne s’épuise par aucune accumulation de termes, si étendue soit-elle. La dénomination d’un objet, pour être féconde sous d’autres rapports, ne saurait remplacer l’observation : la description donnée en des mots par un observateur à un absent n’atteint jamais chez celui-ci la clarté et la précision d’un spectacle vu. Le pouvoir évocateur des mots n’a jamais la même force que la perception originaire. Et celui qui s’efforce à formuler ce qu’il voit ou ce qu’il sent s’en rend compte. Il y a des nuances difficilement exprimables que la vue et les autres sens saisissent sans effort et distinctement, des couleurs, des formes, des odeurs significatives, mais devant l’évocation desquelles l’esprit reste clos. L’évocation par les mots, même là où elle atteint le niveau artistique, reste difficile à concrétiser pour un auditeur ou un lecteur auxquels manque la présence directe des choses : le souvenir de cette présence s’en ressent, car il repose encore sur la perception effacée, qui dépasse toujours en force l’image qui se condense par la reconstruction. Jamais l’aveugle-né ne connaîtra les formes et les couleurs : aucun exposé ne lui fera voir ce qui est refusé à la vue. Autour de l’objet détourné nous distinguerons une ambiance qui pourrait se formuler si l’attention se tournait vers elle et une autre qui demeure perçue sans que l’esprit puisse lui donner une expression. Puisque le non-formulé et le non-formulable ne manquent jamais, il est exclu que l’expression linguistique puisse jamais épuiser tout le perçu. Le concret dépasse en richesse toute expression. Ceci est également le cas pour le côté intérieur de la perception et de son expression. Pendant que je formule ma pensée et que je me concentre sur ce que je veux dire, il reste en moi une ambiance de sensations, de perceptions, de sentiments qui sont tenus à distance par la volonté, sans que pourtant ces réalités puissent être supprimées. La tension spirituelle fait oublier le malaise et la fatigue qui ne reprennent qu’après coup et sont refoulées au point de ne plus être perçues. Il serait pourtant injuste de dire que dans la tension de l’effort intellectuel nous devenons de purs esprits et ne sentons aucunement notre corps ou n’éprouvons aucun sentiment.
Cependant, une précision s’impose. Entre le formulable et le non-formulable il y a non seulement une marge, il y a des transitions : on peut apprendre à formuler et ceci est une question d’instruction et d’exercice. Les auteurs et poètes classiques donnent le modèle de l’extériorisation parfaite. L’expression est l’achèvement de la vie intérieure et celui-ci s’obtient par l’exercice sur les grands modèles. Toutefois, on se demande si l’achèvement n’altère pas ce à quoi il donne de l’expression, si l’expression réussie, par contrecoup et par le sentiment de la réussite même, ne prend pas la place de ce qu’elle vise à extérioriser. Il se pourrait que le vécu perde de son authenticité aussitôt qu’il atteint son extériorisation, ou qu’en tout cas l’expressivité ait une double face : celle de l’adéquation au vécu et celle de son altération. Il n’est pas sûr que celui qui a l’expression facile soit le plus fidèle au vécu qu’il exprime, et il se pourrait que celui qui manque de facilité expressive vive plus authentiquement ce qui ne s’envole pas avec les paroles. Retenons seulement le fait de la difficulté d’expression, dans ses formes objectives – la chose en question se formule difficilement – et subjectives : la personne en question a peu de facilité. Ses deux aspects prouvent que le réel extérieur et intérieur ne sont jamais formulables a priori et d’emblée, mais qu’ils tendent à le devenir et à l’être, et qu’il y a toujours un résidu considérable de non-formulé autour de ce qui réussit à l’être. Tout le monde connaît des situations où la parole s’arrête. Dans la surprise de la joie par exemple, dans le respect, devant la mort ou devant un témoignage d’amour ou de sympathie : il y a des situations où on ne parle pas et où on ne doit ou ne peut pas parler. Ce sont les situations exceptionnelles où l’on reste interdit. On n’est pas maître de son émotion, la parole est coupée. Mais ces situations ne sont pas les seules où le langage fait défaut. Il y a aussi les cas où le langage est arrêté parce qu’il serait superflu. Le langage est superflu partout où il ne ferait que doubler inefficacement la vie de l’individu : les actes habituels qu’accomplit la personne peuvent être accompagnés d’énoncés prononcés à voix basse : maintenant je me lève, je mets mon pardessus et mon chapeau, j’ouvre la porte et je sors. Cette suite d’actes a-t-elle besoin, pour être accomplie, d’être déclenchée par des énoncés ou d’en être accompagnée ? Il est évident que non : l’initiative à laquelle est due cette série d’actes sensés n’est pas due à la parole et n’a aucun rapport avec elle. La fonction du langage interviendrait tout de suite s’il y avait un observateur pour rapporter ces actes successifs. Pour la personne isolée elle n’a aucun sens ; ces actes sont muets et réels. Est-ce que notre vie intérieure, celle que nous menons dans la continuité d’un écoulement tantôt doublée d’actes tournés vers le monde et tantôt se repliant sur elle-même, est-ce que cette vie est accompagnée d’un langage constituant un véritable monologue intérieur ? Il nous semble que l’introspection ne répond pas affirmativement à la question. Il est vrai que, quand nous revenons à nous-mêmes, nos souvenirs contiennent des fragments de discours et de réactions verbales, mais les tensions que ceux-ci provoquent ne sont pas elles-mêmes d’ordre verbal. Aussi est-il impossible de réduire au langage la réalité intérieure entière. Si tout à l’heure nous parlions de l’ambiance vécue qui entoure les actes et les paroles, on doit reconnaître d’autre part qu’il y a des contenus absolument muets dans la conscience qui pourraient être accompagnés de formules, mais cela n’aurait aucun sens puisque la présence de ces contenus est éprouvée directement par la conscience et sans l’intermédiaire du langage : ce qui se passe dans la conscience est présent à la conscience de façon immédiate et sans avoir besoin de lui être signalé par des symboles linguistiques. Méditant sur ces faits immédiatement perçus, nous apercevons que le langage est une fonction conditionnée qui ne couvre nullement la totalité de la vie intérieure et dont la tâche ne saurait être d’éclairer un contenu qui n’a pas besoin d’être mis au jour devant la conscience puisque celle-ci le possède de façon directe. Une fois que nous avons reconnu que le langage est motivé par des tendances, qui, n’ayant aucunement le caractère de paroles, mobilisent pourtant la parole, il nous devient possible de voir dans la rencontre de deux personnes et à travers les mots et les arguments échangés, des volontés qui se cherchent ou bien se dissimulent et dont l’une parfois plie devant l’autre. Ici les actes sont chargés de sens, les situations se traduisent en des réactions trop rapides pour laisser une place à la parole, même intérieure ; cependant des réactions éclairs s’accomplissent avec une sûreté complète, elles ne sont ni incertaines ni vagues, sans que la parole y trouve une place. L’homme renonce à la parole dans des situations où sa vie se joue, où il se concentre pour se sauver, où il redevient l’être qu’il a été avant le contact avec autrui et avant la civilisation. Il retombe à l’extrême pôle de ses possibilités originaires où il fut muet comme il le devient de nouveau à l’autre extrême, celui de l’admiration ou de l’adoration devant le mystère où les mots manquent. Envisagée dans les situations critiques, la parole apparaît comme un luxe pour lequel il n’y a pas de place là où il s’agit de ne perdre aucune énergie, de conserver l’attention le plus indivisée possible, de ne pas glisser de la lutte encore indécise dans un bien-être illusoire où l’on puisse se permettre la détente de la parole. C’est ici que se rangent les activités qui ne souffrent pas qu’on s’étende en paroles, les ordres brefs de l’officier, du commandant, du contremaître dans les hauts-fourneaux, les manipulations muettes et concentrées du mécanicien, du pilote, du chirurgien-opérateur, du joueur de tennis. Il n’y a que la vie moyenne qui offre un terrain favorable au langage.
Cependant, une question surgit qui paraît être une objection : les manœuvres automatisées qui ne sont plus déclenchées par une initiative formulée, ne l’ont-elles pas été à l’origine par elle et celle-ci ne dirige-t-elle pas inconsciemment des actes en apparence indépendants de tout langage ? Nous répondrons que le dictat du langage n’a été que provisoire et surtout que les manœuvres déclenchées par lui ne l’étaient qu’en apparence : ici la parole est un stimulant et non une cause, elle ne fait que dessiner des actes dont le sens est connu par une expérience qui ne relève pas du domaine de la parole. Quand la parole de l’instructeur reste sans effet, celui-ci a toujours la ressource d’exécuter l’acte commandé devant les yeux de son élève. Cette démonstration ad oculos est concrète tandis que la règle formulée ne se concrétise que jusqu’à un certain degré. Ainsi la parole n’est pas indispensable, mais secondaire. L’instruction pratique ne peut généralement pas s’en passer entièrement, mais elle se réduit au minimum, pour venir au secours là où l’instruction par l’exemple concret ne suffit pas. Quand on veut expliquer des significations, il suffit souvent de mimer la chose.
Quelle conclusion allons-nous tirer de ces faits ? S’il y a autour de toute pensée formulée un reste qui n’y entre pas, mais qui est pourtant présent à la conscience ; si celui qui s’exprime difficilement sait pourtant ce qu’il veut tandis que celui qui parle avec abondance et avec grâce le sait peut-être moins bien, si les actes les plus décisifs ne supportent guère d’accompagnement parlé, si la routine professionnelle s’en passe, si l’instruction ne saurait s’intellectualiser au point de pouvoir se passer de renvoyer à la démonstration par l’exemple, ces faits n’obligent-ils pas à reconnaître le caractère auxiliaire et secondaire du langage et à creuser le réel qui se cache plus ou moins sous cette enveloppe ? La première chose à faire serait de réhabiliter la réalité intérieure, dans laquelle se jouent les sentiments, les tendances, les intentions et même les décisions. Pour deux raisons, il sera difficile de les discriminer à l’état pur : d’abord parce que surtout chez l’homme instruit la traduction du vécu se fait immédiatement et involontairement, elle paraît donc contenir le vécu lui-même : il n’est pas aisé de réaliser que la traduction ne fait que se surajouter au vécu. L’autre raison est que nous restons obligés de nommer les objets de notre connaissance et sommes tentés de tenir le langage que nous tenons sur eux pour un langage qui provient d’eux.
Pour ce qui est de la première difficulté, l’histoire des idées vient nous aider. La civilisation connaît des époques où les sentiments et les tendances des individus semblent en harmonie parfaite avec l’expressivité morale et intellectuelle du langage : tout acte se juge d’après les normes stables et la vie intérieure se retrouve entièrement dans le vocabulaire des valeurs qui fait partie du langage. Dans ces périodes tranquilles, il ne devient pas manifeste que la vie intérieure, d’une part, et le langage, de l’autre, sont choses distinctes qui, en certaines circonstances, se recouvrent élément par élément, mais sans garantie de constance. Il arrive, en effet, qu’un courant souterrain de la conscience reste en dehors de l’emprise du vocabulaire existant. Quand ce courant gagne en ampleur et en intensité, quand la discorde entre les formes figées et la vie grandit, il devient à un certain moment manifeste que ces formes ne captent plus le vécu, que celui-ci les déborde et les déforme, sinon même les détruit. En ces périodes de transition, les cadres s’écroulent sous la puissante poussée du fleuve qui monte et la vie cherche des cadres nouveaux. Dans la civilisation hellénique, la perte de l’indépendance de la cité marque une telle transition. Les tâtonnements d’une philosophie qui se tourne vers les problèmes du salut de l’individu en sont le signe. La terminologie change, la forme de l’exposé théorique cède la place à la leçon morale. Quatre siècles plus tard surgit le christianisme d’origine orientale et qui apporte un monde de sentiments inconnus à la civilisation hellénique. Le langage en subit les répercussions : il ne dirige plus, il cède lentement : alors s’établit laborieusement un nouvel ordre d’expression qui est soutenu par une nouvelle mentalité qui s’affirme. À côté du grec des philosophes surgit le grec ecclésiastique, à côté du latin profane le latin chrétien. Les modifications que subit le langage ne s’expliquent pas par le langage même : elles lui viennent de dehors.
La preuve la plus convaincante de l’existence d’une réalité intérieure vécue exempte de langage est fournie par l’observation de la vie animale. L’animal ne parle pas et pourtant il a une vie intérieure manifeste. Il se révèle capable d’apprendre par l’expérience, ce qui serait impossible s’il n’avait une mémoire qui retient l’expérience passée pour en tirer profit quand une expérience analogue se présente, ce qui revient à dire que l’expérience a pour lui une signification, elle signale autre chose qu’elle-même. Un cheval s’agite et refuse de passer quand on l’approche de l’endroit où il a été effrayé par quelque objet. Sa conduite est motivée par une expérience devenue significative ; il n’y a donc pas d’objection à dire que l’animal reconnaît, que l’expérience a laissé en lui une trace ou disposition, à condition de nous rendre compte que nous parlons humainement et analogiquement de ce qui se passe en l’animal. La difficulté est dans le rapport de nos formules aux réalités qu’elles visent. Il est évident que le cheval ne dit pas : voilà l’endroit où j’ai été effrayé, il faut donc que je sois sur mes gardes et que je le contourne. Il se conduit comme s’il se le disait et c’est nous, les observateurs, qui le disons pour lui et à sa place. Il n’y a donc aucune ressemblance entre ce que nous formulons et ce que le cheval fait, et cependant ces formules ont une analogie avec le réel qu’elles visent. En quoi cette analogie consiste-t-elle ? En ceci qu’à la suite articulée de nos mots correspond une suite articulée dans le vécu, avec la différence cependant que dans l’articulation du vécu aucun élément n’existe réellement à l’état isolé, puisque tout se tient intégralement. Les articulations du réel qui sont muettes ne sont donc pas pensables en elles-mêmes ; elles ne sont que des moments d’un procès dynamique dont le début et l’aboutissement sont distincts, mais inséparables, alors que leurs équivalents formulés sont séparables et pensables, à part les uns des autres.
Quand on réfléchit sur ce procès réel et muet qu’on capte dans la formule avec une évidence telle que celle-ci semble se confondre avec le procès même, on découvre qu’il y a un abîme entre le procès vital et la formule correspondants. En effet, la formule n’est pas le procès qu’elle vise : elle ne peut que viser ce procès qui en est indépendant même lorsqu’elle est adéquate ; sa structure la constitue hétérogène. Pour éviter que la formule se confonde avec le procès réel qui se joue chez l’animal, il faut rentrer dans sa peau, il faut tâcher de devenir l’animal tout en poursuivant sa tâche d’observateur. Il faut laisser là les formules et mimer au lieu de parler.
La vie intérieure animale suit donc un procès silencieux, lequel donne naissance à des formes obéissant à un symbolisme, muet également, qui prépare l’avènement du symbolisme linguistique. Ce symbolisme, qui consiste en l’utilisation de l’expérience se retrouve chez l’homme mais là il se double du langage qui soutient et renforce le fonctionnement muet au point de tendre à le remplacer et à en faire oublier l’existence. Nous vivons dans l’ambiance d’un langage qui paraît naturel. Cela nous fait croire que le symbolisme est lié exclusivement à la parole : nous établissons donc un abîme d’abord entre l’activité parlante et non-parlante chez l’homme, ensuite entre la vie intérieure de l’homme et celle des animaux qui ont pourtant avec lui des ressemblances fondamentales. Car on ne saurait nier l’existence de traits communs entre les animaux supérieurs et les hommes : une certaine vie intérieure, une ingéniosité pour résoudre les problèmes pratiques, la présence d’émotions et de sentiments. Ils ont en commun la signification, mais avec cette différence essentielle que chez l’animal la signification est liée à une disposition qui devient réaction dès que la perception se présente. La signification du mur blanc devant lequel le cheval s’effraie ne fait qu’un avec son agitation, elle est vécue plutôt qu’elle n’est consciente ; de toute manière, elle n’est ni détachée ni détachable du courant vital intérieur. Elle est muette, informulée. Chez l’homme, tout au contraire, la signification peut être pensée d’une façon détachée, il n’a pas besoin de se trouver dans une situation où la perception déclenche la signification, il lui suffit d’évoquer cette situation en usant du mot pour devancer la perception, qui sera alors une perception possible et en ce sens inauthentique. La possibilité de détacher et d’objectiver est caractéristique de l’homme disposant de cet instrument qu’est le langage et jouissant par la conscience réflexive de l’usage qu’il en a fait. Celui qui passe ainsi du réel au possible adopte aisément la perspective suivante : jouissant d’un pouvoir théorique, il oublie que celui-ci est conditionné et le prend pour conditionnant la fonction réelle dont il est sorti. Ainsi le théoricien est amené à considérer les possibles théoriques comme antérieurs au réel qui a fourni le point de départ pour les concevoir.
Il y a donc des illusions de la conscience, de cette conscience qui se superpose en spectatrice à la conscience active et vivante, laquelle sans avoir la lucidité de la conscience réfléchie n’est pas pour cela moins sûre d’elle. Cette superposition repose sur le langage.
Il se pourrait – et c’est là une vue hypothétique sur laquelle nous conclurons cet exposé – que la conscience qui objective son propre début ne puisse s’élever au-dessus de sa fonction primaire sans payer son effort d’une illusion. Quoi qu’il en soit, la conscience ne naît pas avec le langage, elle le précède. La vie sans paroles des animaux le prouve et l’observation de la vie humaine le prouve également. Nous sentons l’inexprimable, nous voulons sans formuler, nous observons sans rédiger un protocole, notre conscience personnelle est peut-être pleine de fragments linguistiques qui persévèrent ou renaissent en souvenir de nos contacts avec autrui ; le langage est un fait social, il est l’instrument de l’entente des hommes entre eux. Il n’a pas été fait pour enregistrer le vécu, mais pour faciliter l’entente dans le dialogue. S’il était universellement humain, tout le monde se comprendrait, d’emblée et il n’y aurait ni diversité de langues ni besoin d’un apprentissage. Mais il n’en est pas ainsi. Or, il y a une entente par les gestes, mais elle reste imparfaite. L’individu ne fait pas son langage, il le reçoit. La première fonction du langage n’est pas de révéler les états intérieurs, mais de signaler les besoins, de demander et de commander. Le trafic de la parole a son domaine entre les individus, il ne s’étend pas à ce qui se passe en eux.
Voici la conclusion qui me paraît se dégager de nos méditations : le langage couvre un aspect essentiel de l’être humain, à savoir son engagement dans la vie sociale, dans son existence. L’existence est le plein espace de la personnalité. Mais plus profonde que l’existence est la vie de l’individu. Cette vie tend à devenir existence, mais n’y réussit jamais tout à fait. Elle reste la réalité vécue souterraine, sans paroles, silencieuse et réelle. À mesure que la vie réussit à se couler dans l’existence, elle reste inaperçue, indistincte par rapport à l’existence qui en est le couronnement. Mais dans la mesure où il y a tension et lutte, la vie se fait sentir et apercevoir à travers l’existence. Le langage n’englobe pas le vécu. Mais le vécu est senti, éprouvé par chaque individu, à l’intérieur de lui-même. Il est l’indicible qui se refuse à la révélation par le langage, le tout-individuel qui s’oppose au social, le point de jonction entre le corps que nous sommes et l’esprit que nous avons en commun avec les autres et par lequel nous communions. Une fois qu’on s’est rendu compte de la structure primaire du réel et secondaire du langage qui l’enveloppe, on est tenté de réviser certaines métaphores ayant trait au langage et à la morale. Ainsi les expressions de « voix intérieure », de « voix de la conscience », de « vocation » et d’ « appel » seraient à confronter avec le réel qu’elles désignent. À notre sens, il faudrait dire par exemple que la mauvaise conscience ne parle pas, mais qu’elle mord et que toute vocation est un élan qui dirige l’individu et le contraint à être libre. Les phénomènes de « la conscience » et du « subconscient » demanderaient à être précisés dans un langage aussi sobre que possible en évitant de confondre ce dernier avec le réel auquel il donne forme. Une extrême prudence doit veiller à ce que la formule et le formulé ne soient pas tenus pour identiques.
Le langage humain est enclin à se tenir pour apriorique et indispensable pour que puisse prendre forme la vérité. Il paraît évident que rien ne saurait être vrai sans être formulé. Et cependant la vérité n’a pas besoin de formules pour exister : elle est liée au réel qui, lui, par nature est muet. Pour comprendre la vraie nature du langage, il faut faire l’inverse de ce que fait la conscience qui, prenant possession du langage, lui assigne une valeur absolue et universelle. Il faut le relativiser en montrant que le langage n’a pas de primat sur le réel, mais que c’est le réel qui a le primat sur le langage. Il s’agit de montrer qu’il n’est aucunement la révélation du vécu, mais qu’il sert d’intermédiaire entre les sujets humains ; qu’en cette fonction il n’est pas absolu non plus, mais seulement le prolongement d’une entente plus immédiate et pré-linguistique. Le plus difficile en cette relation est de dissiper l’illusion que crée l’inévitable nécessité de parler sur le vécu et qui consiste dans l’apparence d’une affinité entre les formules et le formulé. Mais cette illusion peut être écartée : une fois qu’on s’est rendu compte de la nature différente du réel, l’argument selon lequel on ne peut s’abstenir d’en parler perd sa force. L’indicible et le muet ne sont pas anéantis du fait que nous en parlons.
Si nous voyons clair dans l’écart du langage et du réel, cette position nous semble correspondre à la situation où vit l’humanité. Le langagen’est plus comme autrefois le symbole de la lumière, le couronnement qui active les actes et les sentiments. Sa transparence s’est révélée insuffisante par rapport à un réel dont l’opacité ne veut plus céder. Les métaphysiciens de la parole sont plus éloignés de nous que Pascal s’écriant que le silence des espaces infinis l’effraie. Le langage est devenu pour nous ambivalent, moins révélateur de l’être qu’il ne le fut autrefois. Mais tout ceci n’est pas sans profit : à travers le voile déchiré du langage, le réel nous apparaît dans sa nature mystérieuse avec un éclat plus fort. L’être nous est devenu moins perméable, la lumière du langage ne le rend pas transparent jusqu’au fond. Tout en admirant un Aristote pour qui tout ce qui est se laisse dire, nous pensons que la lumière du langage l’a trop séduit. Il est possible et même probable qu’à l’avenir l’écart entre le langage et le réel tendra à se réduire et à se fermer. Pour l’instant la distinction s’impose plus que l’union et j’ai tâché de démontrer que cet état de choses n’est pas sans profit pour la connaissance du réel et qu’il faut l’accepter et l’intégrer. Nous serons moins trahis si nous regardons le langage comme un accompagnement plutôt que comme un cadre définitif.
(1956) "Le langage et le vécu", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48, pp.121-129.